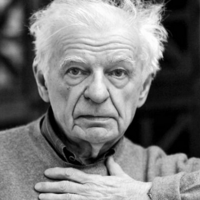Du mouvement et de l’immobilité de douve
Théâtre
Je te voyais courir sur des terrasses, Je te voyais lutter contre le vent, Le froid saignait sur tes lèvres.
II
L’été vieillissant te gerçait d’un plaisir monotone, nous méprisions l’ivresse imparfaite de vivre.
« Plutôt le lierre, disais-tu. l’attachement du lierre aux pierres de sa nuit : présence sans issue, visage sans racine.
« Dernière vitre heureuse que l’ongle solaire déchire, plutôt dans la montagne ce village où mourir.
« Plutôt ce vent... »
III
Il s’agissait d’un vent plus fort que nos mémoires, Stupeur des robes et cri des rocs—et tu passais devant
ces llammes La tète quadrillée les mains Tendues et toute En quête de la mort sur les tambours exultants de les
gestes.
C’était jour de tes seins
Et tu régnais enfin absente de ma tête.
IV
Je me réveille, il pleut. Le vent te pénètre, Douve, lande résineuse endormie près de moi. Je suis sur une terrasse, dans un trou de la mort. De grands chiens de feuillages tremblent.
Le bras que tu soulèves, soudain, sur une porte, m’illumine à travers les âges. Village de braise, à chaque instant je te vois naître, Douve,
A chaque instant mourir.
V
Le bras que l’on soulève et le bras que l’on tourne Ne sont d’un même instant que pour nos lourdes têtes, Mais rejetés ces draps de verdure et de boue Il ne reste qu’un feu du royaume de mort.
La jambe démeublée où le grand vent pénètre Poussant devant lui des têtes de pluie Ne vous éclairera qu’au seuil de ce royaume, Gestes de Douve, gestes déjà plus lents, gestes noirs.
VI
Quelle pâleur te frappe, rivière souterraine, quelle artère en toi se rompt, où l’écho retentit de ta chute ?
Ce bras que tu soulèves soudain s’ouvre, s’enflamme. Ton visage recule. Quelle brunie croissante m’arrache ton regard ? Lente falaise d’ombre, frontière de la mort.
Des bras muets t’accueillent, arbres d’une autre rive.
VII
Blessée confuse dans les feuilles,
Mais prise par le sang de pistes qui se perdent,
Complice encor du vivre.
Je t’ai vue ensablée au terme de ta lutte Hésiter aux confins du silence et de l’eau, Et la bouche souillée des dernières étoiles Rompre d’un cri l’horreur de veiller dans ta nuit.
O dressant dans l’air dur soudain comme une roche Un beau geste de houille.
VIII
La musique saugrenue commence dans les mains, dans les genoux, puis c’est la tète qui craque, la musique s’affirme sous les lèvres, sa certitude pénètre le versant souterrain du visage.
A présent se disloquent les menuiseries faciales. A présent l’on procède à l’arrachement de la vue.
IX
Blanche sous un plafond d’insectes, mal éclairée,
profil Et ta robe tachée du venin des lampes, Je te découvre étendue. Ta bouche plus haute qu’un fleuve se brisant au 1
sur la terre.
Être défait que l’être invincible rassemble. Présence ressaisie dans la torche du froid, O guetteuse toujours je te découvre morte, Douve disant Phénix je veille dans ce froid.
X
Je vois Douve étendue. Au plus haut de l’espace charnel je l’entends bruire. Les princes-noirs hâtent leurs mandibules à travers cet espace où les mains de Douve se développent, os délaits de leur chair se muant en toile grise que l’araignée massive éclaire.
XI
Couverte de l’humus silencieux du monde, Parcourue des rayons d’une araignée vivante. Déjà soumise au devenir du sable Et tout écartelée secrète connaissance.
Parée pour une fête dans le vide
Et les dents découvertes comme pour l’amour.
Fontaine de ma mon présente insoutenable.
XII
Je vois Douve étendue. Dans la ville écarlate de l’air, où combattent les branches sur son visage, où des racines trouvent leur chemin dans son corps—elle rayonne une joie stridente d’insectes, une musique a tireuse.
Au pas noir de la terre, Douve ravagée, exultante, rejoint la lampe noueuse des plateaux.
XIII
Ton visage ce soir éclairé par la terre, Mais je vois les yeux se corrompre Et le mot visage n’a plus de sens.
La mer intérieure éclairée d’aigles tournants, Ceci est une image.
Je te déliens froide à une profondeur où les images ne prennent plus.
XIV
Je vois Douve étendue. Dans une pièce blanche, les veux cernés de plâtre, bouche vertigineuse et les mains condamnées à l’herbe luxuriante qui l’envahit de toutes parts.
La porte s’ouvre. Un orchestre s’avance. Et des yeux à laccttes, des thorax pelucheux, des tètes froides à becs, à mandibules, l’inondent.
XV
O douée d’un profil où s’acharne la terre, Je te vois disparaître.
L’herbe nue sur tes lèvres et l’éclat du silex Inventent ton dernier sourire,
Science profonde où se calcine Le vieux bestiaire cérébral.
XVI
Demeure d’un feu sombre où convergent nos pentes ! Sous ses voûtes je te vois luire. Douve immobile, prise dans le filet vertical de la mort-Douve géniale, renversée : quand au pas des soleils dans l’espace funèbre, elle accède lentement aux étages inférieurs.
XVII
Le ravin pénètre dans la bouche maintenant,
Les cinq doigts se dispersent en hasards de forêt
maintenant, La tête première coule entre les herbes maintenant, La gorge se farde de neige et de loups maintenant, Les yeux ventent sur quels passagers de la mort et c’est
nous dans ce vent dans cette eau dans ce froid
maintenant.
XVIII
Présence exacte qu’aucune flamme désormais ne saurait restreindre ; convoveuse du froid secret ; vivante, de ce sang qui renaît et s’accroît où se déchire le poème.
Il fallait qu’ainsi tu parusses aux limites sourdes, et d’un site funèbre où ta lumière empire, que tu subisses l’épreuve.
O plus belle et la mort infuse dans ton rire ! J’ose à présent te rencontrer, je soutiens l’éclat de tes gestes.
XIX
Au premier jour du froid notre tète s’évade Comme un prisonnier fuit dans l’ozone majeur. Mais Douve d’un instant cette flèche retombe Et brise sur le sol les palmes de sa tète.
Ainsi avions-nous cru réincarner nos gestes, Mais la tète niée nous buvons une eau froide, Et des liasses de mort pavoisent ton sourire. Ouverture tentée dans l’épaisseur du monde.