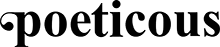Info

Manuel Díaz Martínez (Santa Clara, 13 de septiembre de 1936 – Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2023) fue un poeta, periodista y diplomático cubano de nacimiento, posteriormente nacionalizado español. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española. Fue diplomático en Bulgaria, investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, redactor-jefe del suplemento cultural Hoy Domingo y de La Gaceta de Cuba. Fue uno de los firmantes en 1991 de la Declaración de los intelectuales cubanos (más conocida como Carta de los diez), una carta abierta a Fidel Castro de diez escritores cubanos en la que le solicitaban la democratización del régimen.


Théodore Agrippa d’Aubigné, né le 8 février 1552 au château de Saint-Maury près de Pons, en Saintonge, et mort le 9 mai 1630 à Genève, est un homme de guerre, un écrivain controversiste et poète baroque français. Il est notamment connu pour Les Tragiques, poème héroïque racontant les persécutions subies par les protestants. Calviniste intransigeant, il soutient sans relâche le parti protestant, se mettant souvent en froid avec le roi Henri de Navarre, dont il fut l'un des principaux compagnons d'armes. Après la conversion de celui-ci, il rédigea des textes qui avaient pour but d'accuser Henri IV de trahison envers l'Église. Chef de guerre, il s'illustra par ses exploits militaires et son caractère emporté et belliqueux. Ennemi acharné de l'Église romaine, ennemi de la cour de France et souvent indisposé à l'égard des princes, il s'illustra par sa violence, ses excès et ses provocations verbales.


Auguste Angellier, né le 1er juillet 1848 à Dunkerque et mort le 28 février 1911 à Boulogne-sur-Mer est un poète et universitaire français, qui fut le premier professeur de langue et littérature anglaises de la Faculté des lettres de Lille, avant d'en être son doyen de 1897 à 1900. Critique et historien de la littérature, il fit sensation à la Sorbonne en attaquant les théories d'Hippolyte Taine dans sa thèse sur Robert Burns en 1893. Biographie Né le 1er juillet 1848 à Dunkerque (Nord), d'un père maître-plafonnier et d'une mère secrétaire, Auguste Angellier fut scolarisé à Boulogne-sur-Mer où sa mère l'emmène après s'être séparée de son mari en 1853. Son attachement à cette ville ne se démentit jamais. Jeune homme, il prépare le concours de l'École normale supérieure au Lycée Louis-le-Grand de Paris en 1866. Entre l'écrit et l'oral du concours, il est expulsé du lycée par le censeur qui le considère, à tort selon certains, comme le chef d'un mouvement de révolte concernant la mauvaise qualité de la nourriture à la cantine. Cet épisode catastrophique de sa vie scolaire le pousse à partir, par manque de moyens financiers, pour l'Angleterre où on lui offre un emploi d'enseignant dans un petit pensionnat. Engagé volontaire au cours de la guerre de 1870, il se retrouve à Lyon puis à Bordeaux. Une infection respiratoire grave le fait rentrer à Paris, pendant la Commune, et, la guerre terminée, il est nommé répétiteur en 1871 au Lycée Louis-Descartes (il avait été enfin autorisé à rentrer dans le giron de l’Instruction publique). Il décroche sa licence peu après. Reçu au certificat d’aptitude à l’enseignement de l’anglais, deux ans plus tard, il professe en tant que « maître-répétiteur » pendant trois ans, période exigée à l’époque avant de pouvoir s’inscrire à l’agrégation. Il obtient ce concours à 28 ans, et enseigne aussitôt au lycée Charlemagne, jusqu’à son départ en Angleterre en 1878. Angellier cultive de nombreuses amitiés littéraires, et développe sa sensibilité de poète (sa notoriété lui viendra davantage de son travail universitaire que de son œuvre poétique). Jusqu’à cette période, il hésite entre le journalisme et l’enseignement, mais le congé qui vient de lui être accordé lui permet de s’intéresser au projet de réforme des études de langues vivantes en France (à travers l’étude du fonctionnement des universités anglaises). C’est avec plaisir qu’il s’éloigne un moment de la lourdeur administrative qui lui pèse tant dans sa fonction d’enseignant. En 1881, un poste de maître de conférences, à Douai, lui ouvre une brillante carrière de professeur d’anglais (la faculté des Lettres de Douai va être transférée à Lille en 1887). Douze années plus tard, il soutient ses deux thèses, chacune consacrée à un poète : la « majeure » à l’Écossais Robert Burns, et la thèse complémentaire à John Keats, thèse rédigée en latin ! Le titre de cette dernière : De Johannis Keatsii, vita et Carminibus ; son auteur : Augustus Angellier, literarum doctor in Universitate Insulensi Professor. Même les citations des poèmes de Keats sont en latin (et l’université dont il est question n’est autre que celle de Lille : Universitate Insulensi). Dès lors, Angellier porte le titre de Professeur. De plus, il assure la fonction de président du jury d’agrégation d’anglais de 1890 à 1904 ; et dès février 1897, il assume la tâche de doyen, et les lourdes responsabilités administratives qui s’y attachent. En 1902, détachement (sur un poste de maître de conférences) à l’École normale supérieure, puis retour à Lille en 1904. Auguste Angellier est mort à 62 ans, le 28 février 1911, à Boulogne-sur-Mer. Œuvres En 1896, Angellier le poète a publié À l’amie perdue (178 sonnets inspirés par le chagrin de son histoire d'amour cachée avec Thérèse Fontaine1), et en 1903, Le chemin des saisons. D’autres œuvres suivent : Dans la lumière antique, deux livres de Dialogues et deux d’Épisodes. Curiosité Le compositeur polonais Henryk Opieński (1870-1942) qui dirigeait à Morges (Suisse) l'ensemble Motet et Madrigal a écrit une œuvre pour chœur à 4 voix d'hommes sur le texte poétique La Fuite de l'Hiver qui fait partie du recueil Le chemin des saisons d'Auguste Angellier. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Angellier


François-Marie Arouet, dit Voltairebre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 1778 (à 83 ans), est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle. Représentant le plus connu de la philosophie des Lumières, anglomane, féru d’arts et de sciences, personnage protéiforme et complexe, non dénué de contradictions, Voltaire domine son époque par la durée de sa vie, l’ampleur de sa production littéraire et la variété des combats politiques qu’il a menés. Son influence est décisive sur la bourgeoisie libérale avant la Révolution française et pendant le début du XIXe siècle.

Évariste Désiré de Forges, chevalier puis vicomte de Parny, est un poète français né le 6 février 1753 à Saint-Paul de l’île Bourbon (actuelle île de La Réunion), et mort le 5 décembre 1814 à Paris. Biographie Issu d’une famille originaire du Berry, installée en 1698 à l’île Bourbon, Évariste de Parny est né en 1753 à L’Hermitage de Saint-PaulIl quitte son île natale à l’âge de neuf ans pour venir en France métropolitaine avec ses deux frères, Jean-Baptiste et Chériseuil. Il fait ses études au collège Saint-Thomas de Rennes. D’après l’historien Prosper Ève, « une tradition développée par ses ennemis veut qu’à dix-sept ans, il a envisagé d’embrasser la carrière ecclésiastique et est entré au séminaire de Saint-Firmin avec l’intention ferme de s’enfermer au couvent de La Trappe ». En fait, il a déjà « perdu une foi qui n’a d’ailleurs jamais été trop vive ». La thèse de Catriona Seth montre que les archives confirment le séjour du futur écrivain à Saint-Firmin. Il part officiellement pour cause de maladie mais il s’agit peut-être d’une maladie diplomatique... En définitive, Parny choisit une carrière militaire, celle de ses frères et de son père, après avoir estimé qu’il avait trop peu de religion pour prendre l’habit, le christianisme le séduisant avant tout par les images de la Bible. Son frère Jean-Baptiste, écuyer du comte d’Artois, l’introduit à la cour de Versailles où il fait la connaissance de deux autres militaires qui, comme lui, se feront un nom dans la poésie: Antoine Bertin, originaire comme lui de l’île Bourbon, et de Nicolas-Germain Léonard, qui était, lui, originaire de la Guadeloupe. En 1772, il est capitaine d’une compagnie de gendarmes du Roi. En 1773, son père le rappelle à l’île Bourbon, où il revient âgé. Durant ce séjour, le jeune homme de vingt ans découvre ses dispositions poétiques et tombe passionnément amoureux d’une jeune personne, Esther Lelièvre, que son père l’empêche d’épouser. S’ennuyant de Paris, il retourne en France métropolitaine en 1775 après avoir indiqué dans une lettre à Bertin qu’il ne saurait se plaire dans un pays où se pratique l’esclavage, contre lequel il s’élève. Peu après son départ, la jeune fille dont il s’est épris est mariée à un médecin. Cette histoire inspire au jeune homme les Poésies érotiques, publiées en 1778, où Esther apparaît sous le nom d’Éléonore. Le recueil a d’emblée un grand succès et apporte la célébrité à son auteur. En 1777, il rédige l’Epitre aux insurgents de Boston pour manifester sa solidarité avec les insurgés de la Boston Tea Party, qui réclament la liberté. Selon Prosper Éve, « cet amour de la liberté lui vient certainement de la lecture des philosophes, mais il n’a pu naître et croître que par le spectacle des outrances de la société bourbonnaise ». Le 6 novembre 1779, Parny est nommé capitaine au régiment des dragons de la Reine. En 1783, il revient à l’île Bourbon pour régler la succession de son père et voyage également à l’Île-de-France. En 1785, il quitte l’île Bourbon pour Pondichéry pour suivre, en qualité d’aide de camp, le gouverneur général des possessions françaises dans les Indes. Il ne se plait pas du tout en Inde mais y recueille une part de la matière de ses Chansons madécasses, parmi les premiers poèmes en prose en langue française. Il ne tarde pas à revenir en France pour quitter l’état militaire et s’installer en 1786 dans la maison qu’il possède dans le vallon de Feuillancourt, entre Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi, qu’on appelle la Caserne. Avec Bertin et Léonard, il forme la « société de la caserne », qui a coutume de s’y réunir. Lorsqu’éclate la Révolution française, Parny, qui ne reçoit aucune pension du Roi et qui ne s’intéresse pas particulièrement à la politique, ne se sent pas véritablement concerné. Mais il doit solder les dettes laissées par son frère Jean-Baptiste et, en 1795, les remboursements en assignats le ruinent presque complètement. Il obtient une place dans les bureaux du ministère de l’Intérieur où il reste treize mois, puis à l’administration du théâtre des Arts. En 1804, le comte Français de Nantes le fait entrer dans l’administration des droits réunis. En 1802, Parny se marie avec Marie-Françoise Vally et, l’année suivante, il est reçu à l’Académie française, où il occupe le 36e fauteuil. En 1813, Napoléon Ier lui accorde une pension de 3 000 francs, mais celle-ci lui est supprimée sous la Restauration en 1814. Il meurt le 5 décembre 1814 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (11e division). À cette occasion Pierre-Jean de Béranger écrit une chanson en son hommage, pour laquelle Wilhem compose la musique. Œuvres * La poésie de Parny a été extrêmement populaire au début du XIXe siècle. « Je savais par cœur les élégies du chevalier de Parny, et je les sais encore », écrit ainsi Chateaubriand en 1813. * Le grand écrivain russe Pouchkine, qui écrivit également de la poésie érotique, avait Parny en grande estime et disait de lui: « Parny, c’est mon maître ». * Parny s’est fait connaître par ses Poésies érotiques (1778) qui apportent un peu de fraîcheur dans la poésie académique du XVIIIe siècle. Il reste aussi par ses Chansons madécasses (1787), où il dit traduire des chansons de Madagascar, et qu’on s’entend pour considérer comme le premier essai de poèmes en prose en langue française. Elles ont été illustrées par Jean Émile Laboureur (1920) . Certaines ont été mises en musique: par Maurice Ravel (Chansons madécasses, 1925) et par Zoé De La Rue (Romance: “C’en est fait, j’ai cessé”). * Voyage de Bourgogne, en vers et en prose, avec Antoine Bertin, 1777. * Épître aux insurgents de Boston, 1777. * Poésies érotiques, 1778. * Opuscules poétiques, 1779. * Élégies, 1784. * Chansons madécasses, 1787. * La Guerre des Dieux, poème en 10 chants, 1799: poème condamné par un arrêt du 27 juin 1827 mais qui a souvent été réimprimé clandestinement. * Goddam!, poème en 4 chants, 1804. * Le Portefeuille Volé, 1805, contenant: Les Déguisements de Vénus, Les Galanteries de la Bible, Le Paradis perdu (poème en 4 chants). * Le Voyage de Céline, poème, 1806. * Réflexion amoureuse. Recueil: Poésies érotiques (1778) http://www.poesie-francaise.fr/evariste-de-parny/poeme-reflexion-amoureuse.php Ressources Bibliographie * Par Catriona Seth: * Les poètes créoles du XVIIIe siècle, Paris-Rome, Memini, Bibliographie des écrivains français, 1998, 318 p. * « Le corps d’Eléonore: réflexions sur les Poésies érotiques du chevalier de Parny » in Roman no 25 (1988). * « Chateaubriand et Parny » in Bulletin de la Société Chateaubriand (1989). * « Ginguené et Parny » in Ginguené (1748– 1816), idéologue et médiateur, textes réunis par Edouard Guitton, Rennes, P.U.R., 1995. * « Parny revisité: les lettres de l’abbé du Chatelier à Rosette Pinczon du Sel, un fonds breton inédit » in Cahiers Roucher– André Chénier no 16 (1997). * « Entre autobiographie et roman en vers: les Poésies érotiques » in Autobiographie et fiction romanesque autour des « Confessions », Actes du Colloque de Nice réunis par Jacques Domenech, Nice, Presses universitaires, 1997. * « L’éloge des infidèles chez Parny », in Poétesses et égéries poétiques (1750– 1820), Cahiers Roucher-André Chénier no 17 (1998). * « Les Chansons madécasses de Parny: une poésie des origines aux origines du poème en prose » in Aux origines du poème en prose: la prose poétique, sous la direction de Nathalie Vincent-Munnia, Paris, Champion, 2003, p. 448-457. * « Parny et l’Instruction Publique » in La République directoriale, sous la direction de Philippe Bourdin et Bernard Gainot, Clermont-Ferrand, 1998. * « Un opéra politiquement correct sous le Directoire: L’Alceste de l’an V », Tragédies tardives, p. p. P. Frantz et F. Jacob, Paris, Champion, 2002, p. 169-177. * « Le réseau Parny », Réseaux et sociabilités littéraires en Révolution, sous la direction de Philippe Bourdin et de Jean-Luc Chappey, Clermont-Ferrand, Presses de l’Université Blaise Pascal, 2007, p. 127-141. Articles connexes * Familles subsistantes de la noblesse française Liens externes * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Suède • Bibliothèque apostolique vaticane • Base de bibliothèque norvégienne • WorldCat * Ressources relatives à la littérature: Académie française (membres) • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes * « Évariste de Parny: éléments biographiques et bibliographiques », site Internet de l’Académie de La Réunion. * « Évariste Parny (1753– 1814) », Journal de l’île de La Réunion, avant le 1er janvier 2005. * « Sa généalogie », GeneaNet. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_de_Parny

Louise Colet, née Révoil de Servannes à Aix-en-Provence le 15 septembre 1810 et morte à Paris le 8 mars 1876, est une poétesse et écrivaine française. Âgée d’une vingtaine d’années, Louise Révoil2 épouse Hippolyte-Raymond Colet, un musicien académique, en partie afin d’échapper à la vie provinciale et de résider à Paris.


Leconte de Lisle est un poète français, né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul sur l’île de la Réunion et mort le 17 juillet 1894 à Voisins (Louveciennes). Leconte de Lisle est le vrai nom de famille du poète. Il l’adopta comme nom de plume, sans mentionner ses prénoms (Charles Marie René), et ce choix a été repris dans les éditions de ses œuvres, dans sa correspondance, ainsi que dans la plupart des ouvrages qui lui sont consacrés et dans les anthologies. C’est ce nom qui est utilisé dans la suite de l’article. Son prénom usuel, utilisé par ses proches, était « Charles ».


Alexis-Félix Arvers, né le 23 juillet 1806 à Paris et mort le 7 novembre 1850 à la maison municipale de santé Dubois à Paris est un poète et dramaturge français, célèbre pour son Sonnet, l'une des pièces poétiques les plus populaires de son siècle. Biographie Il était le fils d'un marchand de vins de la ville de Cézy dans l'Yonne, où résidait sa famille. Étudiant en droit avant de devenir clerc de notaire, il poursuivait pourtant déjà ardemment le désir de se faire écrivain. Cédant un jour radicalement à ce qu'il croyait être sa vocation, il parvint à faire jouer une douzaine de comédies légères, le genre de comédies dont raffolait le public petit-bourgeois de Paris (cf. Octave Feuillet). Ces larges succès lui permirent de mener une existence « de dandy », familier des boulevards et des coulisses des petits théâtres, et il se mit à fréquenter le Cénacle de l'Arsenal, fréquentant notamment Alfred Tattet et Alfred de Musset, dont il semble avoir été très proche. À quarante-quatre ans, il décéda d'une maladie de la moelle épinière, pauvre et oublié. L'oubli dans lequel ont plongé ses pièces, pourtant fameuses en leur temps, n'est pas sans rappeler le destin des tragédies de Voltaire. Il publia un recueil de poèmes intitulé Mes Heures perdues (1833). Perdues surtout, a-t-on fait remarquer, pour son employeur, Mr Marcelin-Benjamin Guyet-Desfontaines, notaire, chez qui il avait débuté en qualité de sixième clerc ; mais cet excellent homme, ami des belles-lettres et des poètes romantiques, savait fermer les yeux. Il est enterré à Cézy Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Félix_Arvers
Victor-Louis-Amédée Pommier, né à Vaise (actuellement Lyon) le 20 juillet 1803 et mort le 15 avril 1877 à Paris VIIème arrondissement est un homme de lettres et poète français. Biographie Venu de bonne heure à Paris, après de brillantes études au collège Bourbon, il commença par coopérer à la Collection de classiques latins de Nicolas-Éloi Lemaire, en préparant des notes, revoyant des textes et collationnant des manuscrits. Il prit part à la rédaction de la Semaine, gazette littéraire, fondée en 1824 sous la direction de Victorin et Auguste Fabre et de Villenave Père, et y inséra divers articles de critique et quelques morceaux de poésie. En 1826, il entreprit, comme éditeur, la publication d’une Collection de classiques latins, avec la traduction française en regard, mais il n’en publia que deux ou trois auteurs, dont les Commentaires de César, traduction de Toulangeon, revue par l’éditeur. Il donna en 1827 une traduction de Cornélius Népos à la Bibliothèque latine-française de Panckoucke, et traduisit, pour la même collection, le Dialogue sur la vieillesse de Cicéron.à la poésie. Dans les années 1827-1829, il obtint plusieurs prix de poésie aux Jeux-Floraux de Toulouse, et publia par la suite les pièces couronnées dans son premier recueil de vers. Il occupa la chaire de littérature à l’Athénée royal dans l’hiver de 1828-1829. Un mémoire de lui obtint l’accessit dans le concours ouvert en 1830 par la Revue de Paris sur cette question: « Quelle a été l’influence du gouvernement représentatif sur notre littérature et sur nos mœurs ? » Le rapport disait: « Ce discours, d’un esprit élevé, qui a paru s’éloigner trop souvent de la question proposée, est plein des souvenirs d’une instruction solide que fait valoir encore un style facile et correct. » En 1847, il remporta le prix de poésie décerné par l’Académie française, dont le sujet était la découverte de la vapeur. L’année suivante, la même classe de l’Institut lui décerna une médaille de 1 400 fancs pour sa pièce (non imprimée) sur l’Algérie ou la Civilisation conquérante. En 1849, il obtint à la fois le prix d’éloquence pour l’éloge d’Amyot et le prix de poésie pour la mort de l’archevêque de Paris, coïncidence assez rare dans les fastes académiques et qui lui valut la décoration, sur la proposition d’Alfred de Falloux, alors ministre de l’instruction publique. Le 8 septembre 1880, en réponse à l’envoi de son dernier livre, Gustave Flaubert lui écrit: « Vos Colifichets sont des joyaux Je me suis rué dessus. J’ai lu le volume tout d’une haleine. Je l’ai relu. Il reste sur ma table pour longtemps encore. Partout j’ai retrouvé l’exquis écrivain des Crâneries, des Océanides et de l’Enfer. Je vous connais et depuis longtemps je vous étudie. Il n’est guère possible d’aimer le style sans faire de vos œuvres le plus grand cas. Quelles rimes! Quelle variété de tournures! Quelles surprises d’images! C’est à la fois clair et dense comme du diamant. Vous me semblez un classique dans la meillemot. […] Il faut être fort comme un cabire pour avoir de ces légèretés-là. Vous m’avez fait rêver délicieusement avec l’Égoïste et la Chine. Le Géant m’a « transporté d’enthousiasme ». L’expression, quoique banale, n’est pas trop forte ; je la maintiens.—Les œuvres d’art qui me plaisent par-dessus toutes les autres sont celles où l’art excède. J’aime dans la peinture, la Peinture ; dans les vers, le Ves. Or, s’il fut un artiste au monde, c’est vous. Tour à tour, vos êtes abondant comme une cataracte et vif comme un oiseau. Les phrases découlent de votre sujet naturellement et sans que jamais on voie le dessous. Cela étincelle et chante, reluit, bruit et résiste. […] Je vous aime encore parce que vous n’appartenez à aucune boutique, à aucune église, parce qu’il n’est question, dans votre volume, ni du problème social, ni des bases [de la société], etc.. » Principales publications La Pile de Volta, recueil d’anecdotes publié par un partisan de la littérature galvanique (1831) Poésies (1832) La République, ou le Livre du sang (1836) Les Assassins sans le savoir, drame en 1 acte (1837) Océanides et fantaisies (1839) Texte en ligne Crâneries et dettes de cœur (1842) Texte en ligne Colères (1844) Texte en ligne Les Russes (1854) L’Enfer (1856) De l’Athéisme et du déisme (1857) Colifichets, jeux de rimes, avec les sonnets sur le Salon de 1851 (1860) Paris, poème humoristique (1866) Quelques vers pour elle, poésie intime (1877) Source Notice dans Histoire de la littérature française au XIXe siècle de Frédéric Godefroy (1826-1897), sur GoogleBooks Note Portail de la poésie Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Amédée_Pommier


Sophie d'Arbouville, née le 29 octobre 1810 et morte le 22 mars 1850 à Paris, est une poète et nouvelliste française. Biographie Née le 29 octobre 1810, Sophie de Bezancourt1 est la petite-fille de Sophie d'Houdetot. Elle fréquente dans le salon de celle-ci une société choisie. Léon Séché en fait ce portrait « Elle était plutôt mal de figure, elle avait des traits forts et os yeux ressortis qui, de prime abord, disposaient peu en sa faveur, mais dès qu'elle ouvrait la bouche on oubliait sa laideur relative.» et Sainte-Beuve en a dit « Jeune femme charmante, un peu Diane, sans enfants. Restée enfant et plus jeune que son âge. Pas jolie, mais mieux. » À 22 ans elle épouse le général François d'Arbouville, qu'elle suit dans ses campagnes. Sa santé s'en ressentira. Ne pouvant suivre le général en mission en Afrique elle retourne à Paris et y tient salon. Sa conversation, son amabilité et sa bienveillance sont reconnus de tous. Elle ne tient pas au succès et ses poésies paraissent en petit nombre, pour ses proches, et son couvert d'anonymat. Ses nouvelles publiées dans « La Revue des deux Mondes » le sont sans son consentement, Prendre l'ouvrage d'une femme pour le publier sans lui en demander la permission, c'est un manque de délicatesse. Ce n'est pas la peine de donner mille francs pour échapper à une complète publicité, si le lendemain les revues agissent de cette façon. J'ai écrit moi-même à M. Bulos (sic) une lettre très nette et très ferme qui l'aura un peu surpris, et je l'oblige, pour le prochain n°, à dire qu'il a agi sans mon consentement (Lettre à Sainte-Beuve). La revue ne publiera pas cette protestation, ayant l'assentiment du mari. Elle acceptera plus tard leur édition, mais au profit d'une œuvre caritative. Elle habitait au 10 place Vendôme et y tenait un salon où l'on parlait plus de poésie que de politique. Lamartine était un de ses poètes favoris. Sainte-Beuve, son hôte le plus assidu, en fit sa muse, et lui dédia Le Clou d’or2; elle ne lui céda jamais . En me voyant gémir, votre froide paupière M'a refermé d'abord ce beau ciel que j'aimais, Comme aux portes d'Enfer, de vos lèvres de pierre, Vous m'avez opposé pour premier mot : Jamais ! (À Elle qui était allée entendre des scènes de l'opéra d'Orphée) ; mais ils correspondirent pendant 10 ans. L'été elle résidait à Maisons-Laffitte ou Champlâtreux ; Prosper Mérimée y était reçu ; Chateaubriand y a composé Velléda. Malade La fièvre m'est revenue, avec des douleurs aiguës — des maux de tête terribles., atteinte d'un cancer elle partit en Ariège prendre les eaux de Celles puis rejoint son mari à Lyon. Les événements de juin 18493- altèrent sa santé car elle craint pour la vie du général ; le couple rentre à Paris et c'est là qu'elle meurt, le 22 mars 1850, après une longue maladie.


Manuel José Quintana y Lorenzo (Madrid; 11 de abril de 1772 - ídem; 11 de marzo de 1857), poeta español de la Ilustración y una de las figuras más importantes en la etapa de transición al Romanticismo. Hijo de padres extremeños, estudió en Madrid primeras letras y después latinidad en Córdoba con Manuel de Salas. Después vuelve a Madrid, donde ya el 14 de julio de 1787 recita una oda en la Academia de San Fernando. Pasó a estudiar Derecho en Salamanca, donde se llevó muy bien con el rector liberal Diego Muñoz-Torrero, pero no con quien le sucedió, Tejerizo, quien lo expulsó en 1793, aunque fue readmitido al año siguiente. Sus maestros salmantinos, en derecho y poesía, fueron los neoclásicos Juan Meléndez Valdés, Pedro Estala, Nicasio Álvarez de Cienfuegos y Gaspar Melchor de Jovellanos.


Antoine Tenant de Latour, né à Saint-Yrieix le 30 août 1808, mort à Sceaux le 27 avril 1881, est un écrivain français. Fils de l’éditeur et bibliophile Jean-Baptiste Tenant de Latour (1779-1862), Antoine Tenant de Latour devient, après des études à l’École Normale (1826), précepteur du duc de Montpensier (1832) puis son premier secrétaire en 1843. Homme de lettres et poète, il publie abondamment.


Marcel Proust, né à Paris le 10 juillet 1871 et mort à Paris le 18 novembre 1922, est un écrivain français, dont l’œuvre principale est une suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927. Issu d’une famille aisée et cultivée (son père est professeur de médecine à Paris), Marcel Proust est un enfant de santé fragile et toute sa vie il a des difficultés respiratoires graves causées par l’asthme. Très jeune, il fréquente des salons aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation de dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n’a pas d’emploi et il entreprend en 1895 un roman qui reste à l’état de fragments (publiés en 1952, à titre posthume, sous le titre Jean Santeuil). En 1900, il abandonne son projet et voyage à Venise et à Padoue pour découvrir les œuvres d’art en suivant les pas de John Ruskin sur qui il publie des articles et dont il traduit deux livres : La Bible d’Amiens et Sésame et les Lys. C’est en 1907 que Marcel Proust commence l’écriture de son grand œuvre À la recherche du temps perdu dont les sept tomes sont publiés entre 1913 (Du côté de chez Swann) et 1927, c’est-à-dire en partie après sa mort ; le deuxième volume, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix Goncourt en 1919. Marcel Proust meurt épuisé, le 18 novembre 1922, d’une bronchite mal soignée : il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, accompagné par une assistance nombreuse qui salue un écrivain d’importance que les générations suivantes placeront au plus haut en faisant de lui un véritable mythe littéraire. L’œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective comme sur les fonctions de l’art qui doit proposer ses propres mondes, mais c’est aussi une réflexion sur l’amour et la jalousie, avec un sentiment de l’échec et du vide de l’existence qui colore en gris la vision proustienne où l’homosexualité tient une place importante. La Recherche constitue également une vaste comédie humaine de plus de deux cents acteurs. Proust recrée des lieux révélateurs, qu’il s’agisse des lieux de l’enfance dans la maison de Tante Léonie à Combray ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques et bourgeois, ces mondes étant traités parfois avec une plume acide par un auteur à la fois fasciné et ironique. Ce théâtre social est animé par des personnages très divers dont Marcel Proust ne cache pas les traits comiques : ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles ce qui fait d’À la recherche du temps perdu un roman à clé et le tableau d’une époque. La marque de Proust est aussi dans son style dont on remarque les phrases souvent très longues, qui suivent la spirale de la création en train de se faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité qui échappe toujours. Biographie Enfance Marcel Proust naît à Paris (quartier d’Auteuil dans le 16e arrondissement), dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil, au 96, rue La Fontaine. Cette maison fut vendue puis détruite pour construire des immeubles, eux-mêmes démolis lors du percement de l’avenue Mozart. Sa mère, née Jeanne Clémence Weil, fille d’un agent de change d’origine juive alsacienne et lorraine de Metz, lui apporte une culture riche et profonde. Elle lui voue une affection parfois envahissante. Son père, le Dr Adrien Proust, fils d’un commerçant d’Illiers (en Eure-et-Loir), professeur à la Faculté de médecine de Paris après avoir commencé ses études au séminaire, est un grand hygiéniste, conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies. Marcel a un frère cadet, Robert, né le 24 mai 1873, qui devient chirurgien. Son parrain est le collectionneur d’art Eugène Mutiaux. Sa vie durant, Marcel a attribué sa santé fragile aux privations subies par sa mère au cours de sa grossesse, pendant le siège de 1870, puis pendant la Commune de Paris,. C’est pour se protéger des troubles entraînés par la Commune et sa répression que ses parents ont cherché refuge à Auteuil. L’accouchement est difficile, mais les soins paternels sauvent le nouveau-né. « Peu avant la naissance de Marcel Proust, pendant la Commune, le docteur Proust avait été blessé par la balle d’un insurgé, tandis qu’il rentrait de l’hôpital de la Charité. Madame Proust, enceinte, se remit difficilement de l’émotion qu’elle avait éprouvée en apprenant le danger auquel venait d’échapper son mari. L’enfant qu’elle mit au monde bientôt après naquit si débile que son père craignit qu’il ne fût point viable. On l’entoura de soins ; il donna les signes d’une intelligence et d’une sensibilité précoces, mais sa santé demeura délicate. » Bien que réunissant les conditions pour faire partie de deux religions, fils d’un père catholique et d’une mère juive, lui-même baptisé à l’église Saint-Louis-d’Antin à Paris, Marcel Proust a revendiqué son droit de ne pas se définir lui-même par rapport à une religion. Dreyfusard convaincu, il fut sensible à l’antisémitisme prégnant de son époque, et subit lui-même les assauts antisémites de certaines plumes célèbres. Sa santé est fragile et le printemps devient pour lui la plus pénible des saisons. Les pollens libérés par les fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes crises d’asthme. À neuf ans, alors qu’il rentre d’une promenade au Bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe, sa respiration ne revient pas. Son père le voit mourir. Un ultime sursaut le sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l’enfant, et sur l’homme plus tard : la mort peut le saisir dès le retour du printemps, à la fin d’une promenade, n’importe quand, si une crise d’asthme est trop forte. Années de jeunesse Il est au début élève d’un petit cours primaire, le cours Pape-Carpantier, où il a pour condisciple Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet et de son épouse Geneviève Halévy. Celle-ci tient d’abord un salon chez son oncle, où se réunissent des artistes, puis, lorsqu’elle se remarie en 1886 avec l’avocat Émile Straus, tient son propre salon, dont Proust sera un habitué. Marcel Proust étudie ensuite à partir de 1882 au lycée Condorcet. Il redouble sa cinquième et est inscrit au tableau d’honneur pour la première fois en décembre 1884. Il est souvent absent à cause de sa santé fragile, mais il connaît déjà Victor Hugo et Musset par cœur, comme dans Jean Santeuil. Il est l’élève en philosophie d’Alphonse Darlu, et il se lie d’une amitié exaltée à l’adolescence avec Jacques Bizet. Il est aussi ami avec Fernand Gregh, Jacques Baignères et Daniel Halévy (le cousin de Jacques Bizet), avec qui il écrit dans des revues littéraires du lycée. Le premier amour d’enfance et d’adolescence de l’écrivain est Marie de Benardaky, fille d’un diplomate polonais, sujet de l’empire russe, avec qui il joue dans les jardins des Champs Élysées, le jeudi après-midi, avec Antoinette et Lucie Félix-Faure Goyau, filles du futur président de la République, Léon Brunschvicg, Paul Bénazet ou Maurice Herbette. Il cessa de voir Marie de Benardaky en 1887, les premiers élans pour aimer ou se faire aimer par quelqu’un d’autre que sa mère avaient donc échoué. C’est la première « jeune fille », de celles qu’il a tenté de retrouver plus tard, qu’il a perdue. Les premières tentatives littéraires de Proust datent des dernières années du lycée. Plus tard, en 1892, Gregh fonde une petite revue, avec ses anciens condisciples de Condorcet, Le Banquet, dont Proust est le contributeur le plus assidu. Commence alors sa réputation de snobisme, car il est introduit dans plusieurs salons parisiens et entame son ascension mondaine. Il est ami un peu plus tard avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet, qui a six ans de moins que lui. L’adolescent est fasciné par le futur écrivain. Ils se sont rencontrés au cours de l’année 1895. Leur liaison, au moins sentimentale, est révélée par le journal de Jean Lorrain. Proust devance l’appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire en 1889-1890 à Orléans, au 76e régiment d’infanterie, et en garde un souvenir heureux. Il devient ami avec Robert de Billy. C’est à cette époque qu’il fait connaissance à Paris de Gaston Arman de Caillavet, qui devient un ami proche, et de la fiancée de celui-ci, Jeanne Pouquet, dont il est amoureux. Il s’inspire de ces relations pour les personnages de Robert de Saint-Loup et de Gilberte Il est aussi introduit au salon de Madame Arman de Caillavet à qui il reste attaché, jusqu’à la fin et qui lui fait connaître le premier écrivain célèbre de sa vie, Anatole France (modèle de Bergotte). Rendu à la vie civile, il suit à l’École libre des sciences politiques les cours d’Albert Sorel (qui le juge « fort intelligent » lors de son oral de sortie) et d’Anatole Leroy-Beaulieu. Il propose à son père de passer les concours diplomatiques ou celui de l’École des chartes. Plutôt attiré par la seconde solution, il écrit au bibliothécaire du Sénat, Charles Grandjean, et décide dans un premier temps de s’inscrire en licence à la Sorbonne, où il suit les cours d’Henri Bergson, son cousin par alliance, au mariage duquel il est garçon d’honneur et dont l’influence sur son œuvre a été parfois jugée importante, ce dont Proust s’est toujours défendu. Marcel Proust est licencié ès lettres en mars 1895. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin de siècle, illustré par Madeleine Lemaire, dont Proust fréquente le salon avec son ami le compositeur Reynaldo Hahn. Il a fait connaissance chez Mme Lemaire de Reynaldo Hahn, élève de Jules Massenet, qui vient chanter ses Chansons grises au printemps 1894. Proust, qui a vingt-trois ans, et Reynaldo Hahn, qui vient d’avoir vingt ans, passent une partie de l’été 1894 au château de Réveillon chez Mme Lemaire. Le livre passe à peu près inaperçu et la critique l’accueille avec sévérité—notamment l’écrivain Jean Lorrain, réputé pour la férocité de ses jugements. Il en dit tant de mal qu’il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à la main. Face à lui, également un pistolet à la main, Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud. Tout se termine sans blessures, mais non sans tristesse pour l’auteur débutant. Ce livre vaut à Proust une réputation de mondain dilettante qui ne se dissipe qu’après la publication des premiers tomes d’À la recherche du temps perdu. Rédaction de Jean Santeuil La fortune familiale lui assure une existence facile et lui permet de fréquenter les salons du milieu grand bourgeois et de l’aristocratie du Faubourg Saint-Germain et du Faubourg Saint-Honoré. Il y fait la connaissance du fameux Robert de Montesquiou, grâce auquel il est introduit entre 1894 et le début des années 1900 dans des salons plus aristocratiques, comme celui de la comtesse Greffulhe, cousine du poète et belle-mère de son ami Armand de Gramont, duc de Guiche, de Lady Hélène Standish, née de Pérusse des Cars, de la princesse de Wagram, née Rothschild, de la comtesse d’Haussonville, etc. Il y accumule le matériau nécessaire à la construction de son œuvre : une conscience plongée en elle-même, qui recueille tout ce que le temps vécu y a laissé intact, et se met à reconstruire, à donner vie à ce qui fut ébauches et signes. Lent et patient travail de déchiffrage, comme s’il fallait en tirer le plan nécessaire et unique d’un genre qui n’a pas de précédent, qui n’aura pas de descendance : celui d’une cathédrale du temps. Pourtant, rien du gothique répétitif dans cette recherche, rien de pesant, de roman– rien du roman non plus, pas d’intrigue, d’exposition, de nœud, de dénouement. Le 29 juin 1895, il passe le concours de bibliothécaire à la Mazarine, il y fait quelques apparitions pendant les quatre mois qui suivent et demande finalement son congé. En juillet, il passe des vacances à Kreuznach, ville d’eau allemande, avec sa mère, puis une quinzaine de jours à Saint-Germain-en-Laye, où il écrit une nouvelle, « La Mort de Baldassare Silvande », publiée dans La Revue hebdomadaire, le 29 octobre suivant et dédicacée à Reynaldo Hahn. Il passe une partie de mois d’août avec Reynaldo Hahn chez Mme Lemaire dans sa villa de Dieppe. Ensuite, en septembre, les deux amis partirent pour Belle-Île-en-Mer et Beg Meil. C’est l’occasion de découvrir les paysages décrits par Renan. Il rentre à Paris mi-octobre. C’est à partir de l’été 1895 qu’il entreprend la rédaction d’un roman qui relate la vie d’un jeune homme épris de littérature dans le Paris mondain de la fin du XIXe siècle. On y retrouve l’évocation du séjour à Réveillon qu’il fait à l’automne, encore chez Mme Lemaire, dans son autre propriété. Publié en 1952, ce livre, intitulé, après la mort de l’auteur, Jean Santeuil, du nom du personnage principal, est resté à l’état de fragments mis au net. L’influence de son homosexualité sur son œuvre semble pour sa part importante, puisque Marcel Proust fut l’un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de l’homosexualité (masculine et féminine) dans ses écrits, plus tard. Pour l’instant, il n’en fait aucunement part à ses intimes, même si sa première liaison (avec Reynaldo Hahn) date de cette époque. Léon Daudet décrit Proust arrivant au restaurant Weber vers 1905 : « Vers sept heures et demie arrivait chez Weber un jeune homme pâle, aux yeux de biche, suçant ou tripotant une moitié de sa moustache brune et tombante, entouré de lainages comme un bibelot chinois. Il demandait une grappe de raisin, un verre d’eau et déclarait qu’il venait de se lever, qu’il avait la grippe, qu’il s’allait recoucher, que le bruit lui faisait mal, jetait autour de lui des regards inquiets, puis moqueurs, en fin de compte éclatait d’un rire enchanté et restait. Bientôt sortaient de ses lèvres, proférées sur un ton hésitant et hâtif, des remarques d’une extraordinaire nouveauté et des aperçus d’une finesse diabolique. Ses images imprévues voletaient à la cime des choses et des gens, ainsi qu’une musique supérieure, comme on raconte qu’il arrivait à la taverne du Globe, entre les compagnons du divin Shakespeare. Il tenait de Mercutio et de Puck, suivant plusieurs pensées à la fois, agile à s’excuser d’être aimable, rongé de scrupules ironiques, naturellement complexe, frémissant et soyeux ». L’esthétique de Ruskin Vers 1900, il abandonne la rédaction de ce roman qui nous est parvenu sous forme de fragments manuscrits découverts et édités dans les années 1950 par Bernard de Fallois. Il se tourne alors vers l’esthète anglais John Ruskin, que son ami Robert de Billy, diplomate en poste à Londres de 1896 à 1899, lui fait découvrir. Ruskin ayant interdit qu’on traduise son œuvre de son vivant, Proust le découvre dans le texte, et au travers d’articles et d’ouvrages qui lui sont consacrés, comme celui de Robert de La Sizeranne, Ruskin et la religion de la beauté. À la mort de Ruskin, en 1900, Proust décide de le traduire. À cette fin, il entreprend plusieurs « pèlerinages ruskiniens », dans le nord de la France, à Amiens, et surtout à Venise, où il séjourne avec sa mère, en mai 1900, à l’hôtel Danieli, où séjournèrent autrefois Musset et George Sand. Il retrouve Reynaldo Hahn et sa cousine Marie Nordlinger qui demeurent non loin, et ils visitent Padoue, où Proust découvre les fresques de Giotto, Les Vertus et les Vices qu’il introduit dans La Recherche. Pendant ce temps, ses premiers articles sur Ruskin paraissent dans La Gazette des Beaux Arts. Cet épisode est repris dans Albertine disparue. Les parents de Marcel jouent d’ailleurs un rôle déterminant dans le travail de traduction. Le père l’accepte comme un moyen de mettre à un travail sérieux un fils qui se révèle depuis toujours rebelle à toute fonction sociale et qui vient de donner sa démission d’employé non rémunéré de la bibliothèque Mazarine. La mère joue un rôle beaucoup plus direct. Marcel Proust maîtrisant mal l’anglais elle se livre à une première traduction mot à mot du texte anglais ; à partir de ce déchiffrage, Proust peut alors « écrire en excellent français, du Ruskin », comme le nota un critique à la parution de sa première traduction, La Bible d’Amiens (1904). À l’automne 1900, la famille Proust emménage au 45, rue de Courcelles. C’est à cette époque que Proust fait la connaissance du prince Antoine Bibesco chez sa mère, la princesse Hélène, qui tient un salon où elle invite surtout des musiciens (dont Fauré qui est si important pour la Sonate de Vinteuil, même si c’est finalement la Sonate pour violon et piano no 2 de Brahms qui aura pu servir de modèle à la petite phrase) et des peintres. Les deux jeunes gens se retrouvent après le service militaire dans la Roumanie du prince, en automne 1901. Antoine Bibesco devient un confident intime de Proust, jusqu’à la fin de sa vie, tandis que l’écrivain voyage avec son frère Emmanuel Bibesco, qui aime aussi Ruskin et les cathédrales gothiques. Proust continue encore ses pèlerinages ruskiniens en visitant notamment la Belgique et la Hollande en 1902 avec Bertrand de Fénelon (autre modèle de Saint-Loup) qu’il a connu par l’intermédiaire d’Antoine Bibesco et pour qui il éprouve un attachement qu’il ne peut avouer. Le départ du fils cadet, Robert, qui se marie en 1903, transforme la vie quotidienne de la famille. L’écriture de La Recherche La première phrase de l’œuvre est posée en 1907. Pendant quinze années, Proust vit en reclus dans sa chambre tapissée de liège, au deuxième étage du 102, boulevard Haussmann, où il a emménagé le 27 décembre 1906 après la mort de ses parents, et qu’il quittera en 1919. Portes fermées, Proust écrit, ne cesse de modifier et de retrancher, d’ajouter en collant sur les pages initiales les « paperolles » que l’imprimeur redoute. Plus de deux cents personnages vivent sous sa plume, couvrant quatre générations. Après la mort de ses parents, sa santé déjà fragile se détériore davantage en raison de son asthme. Il s’épuise au travail, dort le jour et ne sort—rarement—que la nuit tombée et dînant souvent au Ritz, seul ou avec des amis. Son œuvre principale, À la recherche du temps perdu, est publiée entre 1913 et 1927. Le premier tome, Du côté de chez Swann (1913), est refusé chez Gallimard sur les conseils d’André Gide, malgré les efforts du prince Antoine Bibesco et de l’écrivain Louis de Robert. Gide exprime ses regrets par la suite. Finalement, le livre est édité à compte d’auteur chez Grasset. L’année suivante, le 30 mai, Proust perd son secrétaire et ami, Alfred Agostinelli, dans un accident d’avion. Ce deuil, surmonté par l’écriture, traverse certaines des pages de La Recherche. Les éditions Gallimard acceptent le deuxième volume, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, pour lequel Proust reçoit en 1919 le prix Goncourt. C’est l’époque où il songe à entrer à l’Académie française, où il a des amis ou soutiens tels que Robert de Flers, René Boylesve, Maurice Barrès, Henri de Régnier... Il ne lui reste plus que trois années à vivre. Il travaille sans relâche à l’écriture des cinq livres suivants de La Recherche et meurt, épuisé, le 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. Il demeurait au 44, rue de l’Amiral-Hamelin à Paris. Une photographie, prise par Man Ray à la demande de Jean Cocteau, montre Marcel Proust sur son lit de mort, le 20 novembre. Les funérailles ont lieu le lendemain, 21 novembre, en l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d’honneur. L’assistance est nombreuse. Barrès dit à Mauriac sur le parvis de l’église : « Enfin, c’était notre jeune homme ! » Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, division 85. Les œuvres Les Plaisirs et les Jours Les Plaisirs et les Jours est un recueil de poèmes en prose et de nouvelles publié par Marcel Proust en 1896 chez Calmann-Lévy. Ce recueil s’inspire fortement du décadentisme et notamment du travail du dandy Robert de Montesquiou. Il s’agit du premier ouvrage de son auteur, qui cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de La Recherche. Jean Santeuil En 1895, Proust entreprend l’écriture d’un roman mettant en scène un jeune homme qui évolue dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Considéré comme une ébauche de La Recherche, Jean Santeuil ne constitue pas un ensemble achevé. Proust y évoque notamment l’affaire Dreyfus, dont il fut l’un des témoins directs. Il est l’un des premiers à faire circuler une pétition favorable au capitaine français accusé de trahison et à la faire signer par Anatole France. Les traductions de Ruskin La Bible d’Amiens (Wikisource) Sésame et les lys (Wikisource)Proust traduit La Bible d’Amiens (1904), de John Ruskin, et ce travail, ainsi que sa deuxième traduction, Sésame et les Lys (1906), est salué par la critique, dont Henri Bergson. Cependant, le choix des œuvres traduites ne se révèle pas heureux et l’ensemble est un échec éditorial. C’est pourtant pour le futur écrivain un moment charnière où s’affirme sa personnalité. En effet, il accompagne ses traductions de notes abondantes et de préfaces longues et riches qui occupent une place presque aussi importante que le texte traduit. Surtout, en traduisant Ruskin, Proust prend peu à peu ses distances avec celui-ci, au point de critiquer ses positions esthétiques. Cela est particulièrement perceptible dans le dernier chapitre de sa préface à La Bible d’Amiens qui tranche avec l’admiration qu’il exprime dans les trois premiers. Il reproche notamment à Ruskin son idolâtrie esthétique, critique qu’il adressa également à Robert de Montesquiou et qu’il fit partager par Swann et dans la Recherche. Pour Proust, c’est dévoyer l’art que d’aimer une œuvre parce que tel écrivain en parle ; il faut l’aimer pour elle-même. Contre Sainte-Beuve Le Contre Sainte-Beuve n’existe pas réellement : il s’agit d’un ensemble de pages, publiées à titre posthume en 1954 sous la forme d’un recueil associant des courts passages narratifs et de brefs essais (ou esquisses d’essais) consacrés aux écrivains que Proust admirait tout en les critiquant : Balzac, Flaubert, etc. Il y attaque Charles-Augustin Sainte-Beuve et sa méthode critique selon laquelle l’œuvre d’un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et ne pourrait s’expliquer que par elle. En s’y opposant, Proust fonde sa propre poétique ; on peut considérer À la recherche du temps perdu comme une réalisation des idées exposées dans ces pages, dont certaines sont reprises par le narrateur proustien dans Le Temps Retrouvé, ou attribuées à des personnages ; d’autre part, nombre de passages narratifs ont été développés dans le roman. Pastiches et Mélanges Pastiches et Mélanges est une œuvre que Proust publie en 1919 à la NRF. Il s’agit d’un recueil de préfaces et d’articles de presse parus principalement dans Le Figaro à partir de 1908, rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard. Un extrait de cette oeuvre “ Journées de Lecture ”, préface à la traduction de Sésame et les lys de Ruskin, a été publié notamment chez 10-18, 1993 (ISBN 2-2640 1811-9), Gallimard, 2017 (ISBN 978-2-0727-0534-2) et Publie.net. À la recherche du temps perdu Des critiques[Qui ?] ont écrit que le roman moderne commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion d’intrigue, l’écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité de l’âme. La composition de La Recherche en témoigne : les thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de correspondances qui s’apparentent à la poésie. Proust voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des fluctuations de la mémoire affective. Il laisse des portraits uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l’amour et la jalousie, une image de la vie, du vide de l’existence, et de l’art. Son style écrit évoque son style parlé, caractérisé par une phrase parfois longue, « étourdissante dans ses parenthèses qui la soutenaient en l’air comme des ballons, vertigineuse par sa longueur, (...) vous engaînait dans un réseau d’incidentes si emmêlées qu’on se serait laissé engourdir par sa musique, si l’on n’avait été sollicité soudain par quelque pensée d’une profondeur inouïe », mais selon « un rythme d’une infinie souplesse. Il le varie au moyen de phrases courtes, car l’idée populaire que la prose de Proust n’est composée que de phrases longues est fausse (comme si d’ailleurs les phrases longues étaient un vice) ». « Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y ait d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini et qui, bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial. « Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l’expérience, sous des mots, quelque chose de différent, c’est exactement le travail inverse de celui que, chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l’amour-propre, la passion, l’intelligence, et l’habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie ». (Le Temps retrouvé) L’œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion majeure sur le temps. La « Recherche du Temps Perdu » permet de s’interroger sur l’existence même du temps, sur sa relativité et sur l’incapacité à le saisir au présent. Une vie s’écoule sans que l’individu en ait conscience et seul un événement fortuit constitué par une sensation—goûter une madeleine, buter sur un pavé—fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé, perdu, a une valeur (notion de « réminiscence proustienne »). Le temps n’existe ni au présent, ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. La descente de l’escalier de Guermantes au cours de laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l’impossibilité qu’il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres. On garde toute sa vie l’image des êtres tels qu’ils nous sont apparus le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables jusqu’à ce que les ayant reconnus l’individu prenne conscience de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne son unité au quotidien fragmenté. L’analyse du snobisme et de la société aristocratique et bourgeoise de son temps fait de l’œuvre de Proust une interrogation majeure des mobiles sociaux de l’individu et de son rapport aux autres, instruments de l’ascension sociale. Comme Honoré de Balzac, Marcel Proust a su créer un monde imaginaire, peuplé de personnages devenus aujourd’hui des types sociaux ou moraux. Comme le Père Goriot, Eugénie Grandet, la Duchesse de Langeais ou Vautrin chez Balzac, Madame Verdurin, la duchesse de Guermantes, Charlus ou Charles Swann sont, chez Proust, des personnages en lesquels s’incarne une caractéristique particulière : ambition, désintéressement, suprématie mondaine, veulerie,,. L’amour et la jalousie sont analysés sous un jour nouveau. L’amour n’existe chez Swann, ou chez le Narrateur, qu’au travers de la jalousie. La jalousie, ou le simple fait de ne pas être l’élu, génèrerait l’amour, qui une fois existant, se nourrirait non de la plénitude de sa réalisation, mais de l’absence. Swann n’épouse Odette de Crécy que lorsqu’il ne l’aime plus. Le Narrateur n’a jamais autant aimé Albertine que lorsqu’elle a disparu (voir Albertine disparue). On n’aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d’inaccessible, on n’aime que ce qu’on ne possède pas, écrit par exemple Proust dans La Prisonnière. Cette théorie développée dans l’œuvre reflète exactement la pensée de Proust, comme l’illustre la célèbre rencontre entre l’écrivain et le jeune Emmanuel Berl, rencontre que ce dernier décrira dans son roman Sylvia (1952). Lorsque Berl lui fait part de l’amour partagé qu’il éprouve pour une jeune femme, Proust dit sa crainte que Sylvia ne s’interpose entre Berl et son amour pour elle, puis devant l’incompréhension de Berl, qui maintient qu’il peut exister un amour heureux, se fâche et renvoie le jeune homme chez lui. La Recherche réserve une place importante à l’analyse de l’homosexualité, en particulier dans Sodome et Gomorrhe où apparaît sous son vrai jour le personnage de Charlus. Enfin, l’œuvre se distingue par son humour et son sens de la métaphore. Humour, par exemple, lorsque le Narrateur reproduit le style lyrique du valet Joseph Périgot ou les fautes de langage du directeur de l’hôtel de Balbec, qui dit un mot pour un autre (« le ciel est parcheminé d’étoiles », au lieu de « parsemé »). Sens de la métaphore, lorsque le Narrateur compare le rabâchage de sa gouvernante, Françoise, une femme d’extraction paysanne qui a tendance à revenir régulièrement sur les mêmes sujets, au retour systématique du thème d’une fugue de Bach. Anecdotes Surnoms et pseudonymes La mère de Proust lui donnait, enfant, des surnoms affectueux, tels « mon petit jaunet » (un jaunet est un louis d’or ou un franc Napoléon en or), « mon petit serin », « mon petit benêt » ou « mon petit nigaud ». Dans ses lettres, son fils était « loup » ou « mon pauvre loup ». Ses amis et relations lui attribuaient d’autres sobriquets, plus ou moins amicaux, tels que « Poney », « Lecram » (anacyclique de Marcel), l’« Abeille des fleurs héraldiques », le « Flagorneur » ou le « Saturnien », et ils utilisaient le verbe « proustifier » pour qualifier sa manière d’écrire. Dans les salons, il était « Popelin Cadet », et ses dîners mémorables dans le grand hôtel parisien lui ont valu l’appellation de « Proust du Ritz ». Le romancier Paul Bourget affubla Proust d’un sobriquet faisant référence à son goût pour les porcelaines de Saxe. Il écrivit à la demi-mondaine Laure Hayman, amie des deux écrivains : « (...) votre saxe psychologique, ce petit Marcel (...) tout simplement exquis ». Laure Hayman avait donné à Marcel Proust un exemplaire de la nouvelle de Paul Bourget Gladys Harvey relié dans la soie d’un de ses jupons. Laure était le modèle supposé du personnage créé par Bourget, et avait écrit sur l’exemplaire offert à Proust une mise en garde : « Ne rencontrez jamais une Gladys Harvey ». Dans ses écrits, Proust a souvent employé des pseudonymes. Ses publications dans la presse sont signées Bernard d’Algouvres, Dominique, Horatio, Marc-Antoine, Écho, Laurence ou simplement D. Illiers-Combray Le village d’Illiers, en Eure-et-Loir, inspira à Proust le lieu fictif de Combray. À l’occasion du centenaire de sa naissance, en 1971, ce village d’Illiers où, enfant, le « petit Marcel » venait passer ses vacances chez sa tante Élisabeth Amiot, lui rendit hommage en changeant de nom pour devenir Illiers-Combray. C’est l’une des rares communes françaises à avoir adopté un nom emprunté à la littérature. La « maison de Tante Léonie », où Proust passa ses vacances d’enfance entre 1877 et 1880, est devenue le Musée Marcel Proust. Un timbre français de 0.30 + 0.10 de 1966 représente Marcel Proust avec le pont Saint-Hilaire à Illiers. Le questionnaire L’écrivain est également connu pour le Questionnaire de Proust (1886), en réalité un simple questionnaire de personnalité auquel il répondit par hasard dans son adolescence, et qui donna à Bernard Pivot l’idée d’élaborer le sien. Quelques réponses sont restées historiques, par exemple, à l’interrogation « Comment aimeriez-vous mourir ? », la réplique : « J’aimerais mieux pas. » Quelques années après son apparition chez Bernard Pivot, le questionnaire traversa l’Atlantique pour se retrouver dans l’émission télévisée Actors’ Studio, où James Lipton interviewe les stars du grand écran. Postérité Avec le temps, Proust s’impose comme l’un des auteurs majeurs du XXe siècle et est considéré dans le monde comme l’un des écrivains, voire l’écrivain le plus représentatif de la littérature française, au même titre que le sont Shakespeare, Cervantes, Dante et Goethe dans leurs pays respectifs, et est identifié à l’essence de ce qu’est la « littérature ». Il s’est écrit davantage de livres sur lui que sur tout autre écrivain français. Publications Ouvrages antérieurs à La Recherche Publiés par ProustLes Plaisirs et les Jours, Calmann-Lévy, 1896 La Bible d’Amiens, préface, traduction et notes de l’ouvrage de John Ruskin The Bible of Amiens, Mercure de France, 1904 Sésame et les lys, traduction de l’ouvrage de John Ruskin Sesame and Lilies, Mercure de France, 1906Ces deux ouvrages de Ruskin ont été réunis dans une édition critique établie par Jérôme Bastianelli, collection Bouquins, Robert Laffont, 2015 Pastiches et Mélanges, NRF, 1919Éditions posthumes Chroniques, 1927 Jean Santeuil, 1952 Contre Sainte-Beuve, 1954 Le chagrin de la marquise, 1961 Chardin et Rembrandt, Le Bruit du temps, 2009 Le Mensuel retrouvé, précédé de « Marcel avant Proust » de Jérôme Prieur (sous-titré Inédits), éditions des Busclats, novembre 2012 Mort de ma grand-mère, suivie d’une conclusion de Bernard Frank (écrivain). Grenoble, Éditions Cent Pages, 2013 (ISBN 978-2-9163-9041-3) À la recherche du temps perdu Éditions originalesDu côté de chez Swann, Grasset, 1913 Partie 1 : Combray Partie 2 : Un amour de Swann Partie 3 : Noms de pays : le nom À l’ombre des jeunes filles en fleurs, NRF, 1918, prix Goncourt Partie 1 : Autour de Mme Swann Partie 2 : Noms de pays : le pays Le Côté de Guermantes I et II, NRF, 1921-1922 Sodome et Gomorrhe I et II, NRF, 1922-1923 La Prisonnière, NRF, 1923 Albertine disparue (La Fugitive), 1925 Le Temps retrouvé, NRF, 1927Éditions diversesA la recherche du temps perdu : L’essentiel lu par Daniel Mesguich aux éditions Frémeaux & Associés Du côté de chez Swann Vol.1– Coffret 4 CD A l’ombre des jeunes filles en fleurs Vol. 2– Coffret 4 CD Le Côté de Guermantes Vol. 3– Coffret 4 CD Sodome et Gomorrhe Vol. 4– Coffret 4 CD Gallimard : Les quatre versions chez Gallimard utilisent toutes le même texte : Pléiade : édition en 4 volumes, avec notes et variantes Folio : édition en 7 volumes, poche Collection blanche : édition en 7 volumes, grand format Quarto : édition en 1 volume, grand format Garnier-Flammarion : édition en 10 volumes, poche Livre de Poche : édition en 7 volumes, poche Bouquins, Robert Laffont : édition en 3 volumes, grand format Omnibus, Presses de la Cité : édition en 2 volumes, grand format Intégrale, lue par André Dussollier, Guillaume Gallienne, Michael Lonsdale, Denis Podalydès, Robin Renucci et Lambert Wilson aux éditions Thélème Texte intégral de l’édition Gallimard de 1946-1947 en ligne sur Gutenberg Le manuscrit retrouvé d’À la recherche du temps perdu, Éditions des Saints-Pères, 2016 Correspondance Plusieurs volumes posthumes, publiés à partir de 1926. Robert de Billy, Marcel Proust, Lettres et conversations, Paris, Éditions des Portiques, 1930 Une première édition en 6 tomes (classée par correspondants), publiée par Robert Proust et Paul Brach : Correspondance générale (1930-1936). Une grande édition de référence en 21 tomes, où les lettres des volumes précédents sont reprises, augmentées, dotées d’une annotation universitaire et classées chronologiquement par Philip Kolb : Correspondance (Plon, 1971-1993). Une édition anthologique de l’édition de Philip Kolb, corrigée et présentée par Françoise Leriche, avec de nouvelles lettres inédites : Marcel Proust, Lettres (Plon, 2004). Bibliographie Ouvrages généraux Pierre Abraham, Proust, Rieder, 1930 Pierre Assouline, Autodictionnaire Proust, Omnibus, 2011 Jérôme Bastianelli, Dictionnaire Proust-Ruskin, Classiques Garnier, 2017, (ISBN 978-2-406-06716-0) Samuel Beckett, Proust, essai composé en anglais en 1930, traduit en français par É. Fournier, Les Éditions de Minuit, 1990 Annick Bouillaguet, Brian G. Rogers (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, coll. « Dictionnaires et références », 2004 Georges Cattaui, Marcel Proust, Proust et son Temps, Proust et le Temps, préface de Daniel-Rops, Julliard, 1953 Pietro Citati, La Colombe poignardée, Proust et la Recherche, Gallimard, 1997 Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Le Seuil, 1989 Antoine Compagnon et autres, Un été avec Proust, Éd. des Équateurs, 2014 Ernst Robert Curtius, Marcel Proust, Paris, La Revue Nouvelle, 1928 Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1970 Ghislain de Diesbach, Proust, Perrin, 1991 Roger Duchêne, L’Impossible Marcel Proust, Robert Laffont, 1994 Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, Plon/Grasset, 2013 Michel Erman, Marcel Proust, Fayard, 1994 Ramon Fernandez, À la gloire de Proust, Éditions de La Nouvelle Revue Critique, 1943 rééd. Grasset sous le titre Proust, 2009 (ISBN 9782246075226). Luc Fraisse, L’Éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, coll. Lettres françaises, 2013. Laure Hillerin, Proust pour Rire– Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, Flammarion, 2016. Edmond Jaloux, Avec Marcel Proust, La Palatine, Genève, 1953 Julia Kristeva, Le Temps sensible : Proust et l’expérience littéraire, Folio Essai, 2000 Giovanni Macchia, L’Ange de la Nuit (Sur Proust), Gallimard, 1993 Diane de Margerie, Proust et l’obscur, Albin Michel, 2010 Diane de Margerie, À la recherche de Robert Proust, Flammarion, 2016 Claude Mauriac, Proust par lui-même, coll. « Écrivains de toujours », Seuil, 1953 François Mauriac, Du côté de chez Proust, La Table ronde, 1947 André Maurois, À la recherche de Marcel Proust, Hachette, 1949, étude et biographie littéraire. Ouvrage collectif, Proust, Hachette (coll. « Génies et réalités »), c1965, 1972 George D. Painter, Marcel Proust, 2 vol., Mercure de France, 1966-1968, traduit de l’anglais et préfacé par Georges Cattaui ; édition revue, en un volume, corrigée et augmentée d’une nouvelle préface de l’auteur, Mercure de France, 1992 Gaëtan Picon, Lecture de Marcel Proust, Mercure de France, 1963 Jérôme Picon, Marcel Proust, une vie à s’écrire, Flammarion, 2016 Léon Pierre-Quint, Marcel Proust, sa vie, son œuvre, Sagittaire, 1946 Jean-François Revel, Sur Proust, Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 1987 Jean-Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Seuil, 1974 Ernest Seillière, Marcel Proust, Éditions de La Nouvelle Revue critique, 1931 Anne Simon, Proust ou le réel retrouvé, Paris, PUF, 2000 Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, NRF/Biographie, Gallimard, 1996 Jean-Yves Tadié, De Proust à Dumas, Gallimard (coll. « Blanche »), 2006 Edmund White, Marcel Proust, Fides, 2001 Ouvrages iconographiques Georges Cattaui, Proust, documents iconographiques, éditions Pierre Cailler, collection « Visages d’hommes célèbres », 1956, 248 pages illustrées de 175 photos relatives à Marcel Proust. Collectif, Le Monde de Proust vu par Paul Nadar, édition du Centre des monuments nationaux / Éditions du Patrimoine, 1999– (ISBN 9782858223077) Pierre Clarac et André Ferré, Album Proust, Gallimard, collection Albums de la Pléiade, 1965. Eric Karpeles, Le musée imaginaire de Marcel Proust– Tous les tableaux de A la recherche du temps perdu, traduit de l’anglais par Pierre Saint-Jean, Thames and Hudson, 2017 André Maurois, Le Monde de Marcel Proust, Hachette, 1960 Mireille Naturel et Patricia Mante-Proust, Marcel Proust. L’Arche et la Colombe, Michel Lafon, 2012. Jérôme Picon, Marcel Proust, album d’une vie, Textuel, 1999. Henri Raczymow, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Parigramme, 1995. Monographies Céleste Albaret (et Georges Belmont), Monsieur Proust, Robert Laffont, 1973. Jacques Bersani (éd.), Les Critiques de notre temps et Proust, Garnier, 1971. Catherine Bidou-Zachariasen, Proust sociologue. De la maison aristocratique au salon bourgeois, Descartes, 1997. Maurice Blanchot, « L’étonnante patience », chapitre consacré à Marcel Proust dans le Livre à venir, Gallimard, 1959. Brassaï, Marcel Proust sous l’emprise de la photographie, Gallimard, 1997. Étienne Brunet, Le Vocabulaire de Marcel Proust, avec l’Index complet et synoptique de À la recherche du temps perdu, 3 vol., 1918 p., Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1983 (préface de J.Y. Tadié). (ISBN 2051004749) (ISBN 9782051004749). Alain Buisine, Proust et ses lettres, Presses Universitaires de Lille, coll. « Objet », 1983. Jean-Yves Tadié, Marcel Proust : La cathédrale du temps, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard/Littératures » (no 381), 1999, rééd. 2017 Philippe Chardin, Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare, Honoré Champion, 2006. Philippe Chardin, Originalités proustiennes, Kimé, 2010 Philippe Chardin et Nathalie Mauriac Dyer, Proust écrivain de la Première Guerre mondiale, Dijon, EUD, 2014. Józef Czapski, Proust contre la déchéance : Conférence au camp de Griazowietz, Noir sur blanc, 2004 et 2011. Serge Doubrovsky, La Place de la madeleine, Écriture et fantasme chez Proust, Mercure de France, 1974. Robert Dreyfus, Souvenirs sur Marcel Proust (accompagnés de lettres inédites), Paris, Grasset, 1926. Maurice Duplay, Mon ami Marcel Proust : souvenirs intimes. Cet ouvrage contient notamment une lettre de Marcel Proust à Maurice Duplay, Editions Gallimard, 1972 Clovis Duveau, Proust à Orléans, édité par les Musées d’Orléans, 1998. Michel Erman, Le Bottin proustien. Qui est dans « La Recherche » ?, Paris, La Table Ronde, 2010. Michel Erman, Le Bottin des lieux proustiens, La Table ronde, 2011. Luc Fraisse, L’Œuvre cathédrale. Proust et l’architecture médiévale, José Corti, 1990, 574 pages. Louis Gautier-Vignal, Proust connu et inconnu, Robert Laffont, 1976. Jean-Michel Henny, Marcel Proust à Évian. Étape d’une vocation. Chaman édition, Neuchâtel, 2015. Geneviève Henrot Sostero, Pragmatique de l’anthroponyme dans À la recherche du temps perdu, Paris, Champion, 2011. Anne Henry, La Tentation de Proust, Paris, PUF, 2000, (ISBN 2-13-051075-2) Laure Hillerin, La comtesse Greffulhe. L’ombre des Guermantes, Flammarion, 2014. Philip Kolb, La correspondance de Marcel Proust, chronologie et commentaire critique, University of Illinois Press, 1949 Elisabeth Ladenson, Proust lesbien (préface d’Antoine Compagnon), Ed. EPEL 2004. Luc Lagarde, Proust à l’orée du cinéma, L’âge d’Homme, 2016 Nathalie Mauriac Dyer, Proust inachevé, le dossier Albertine disparue, Honoré Champion, 2005. Marie Miguet-Ollagnier, La Mythologie de Marcel Proust, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Annales littéraires de l’Université de Besançon », 1982, 425 p. (ISBN 2-251-60276-3). Christian Péchenard, Proust à Cabourg ; Proust et son père ; Proust et Céleste, in Proust et les autres, Éditions de la Table ronde, 1999. Léon Pierre-Quint, Comment travaillait Proust, Bibliographie, Les Cahiers Libres, 1928. Georges Poulet, L’Espace proustien, Gallimard, 1963. Jérôme Prieur, Proust fantôme, Gallimard, 2001 et 2006 Jérôme Prieur Marcel avant Proust, suivi de Proust, Le Mensuel retrouvé, éditions des Busclats, 2012 Henri Raczymow, Le Cygne de Proust, Gallimard, coll. L’un et l’autre, 1990. Jean Recanati, Profils juifs de Marcel Proust, Paris, Buchet-Chastel, 1979. Thomas Ravier, Éloge du matricide : Essai sur Proust, Gallimard, coll. « L’Infini », Paris, 2008, 200 p. (ISBN 978-2-07-078443-1) Jacqueline Risset, Une certaine joie. Essai sur Proust, Éditions Hermann, 2009. Jean-Yves Tadié (dir.), Proust et ses amis, Colloque fondation Singer-Polignac, Gallimard, « Les cahiers de la NRF », 2010. Nayla Tamraz, Proust Portrait Peinture, Paris, Orizons, coll. Universités/Domaine littéraire, 2010 Davide Vago, Proust en couleur, coll. « Recherches proustiennes », Honoré Champion, 2012 (ISBN 9782745323927) Stéphane Zagdanski, Le Sexe de Proust, Gallimard, 1994 (ISBN 2070738779) Adaptations Filmographie Céleste, de Percy Adlon, film allemand avec pour personnage principal Céleste Albaret (1981). Le Temps retrouvé, de Raoul Ruiz (1998). Un amour de Swann, de Volker Schlöndorff (1984). La Captive, de Chantal Akerman (2000). À la recherche du temps perdu, téléfilm en deux parties de Nina Companeez (diffusé sur France 2 en février 2011). Divers Suso Cecchi D’Amico et Luchino Visconti : À la recherche du temps perdu, scénario d’après Marcel Proust, Persona, 1984. Harold Pinter : Le Scénario Proust : À la recherche du temps perdu, avec la collaboration de Joseph Losey et Barbara Bray, traduction de l’anglais par Jean Pavans, scénario d’après Marcel Proust, Gallimard, Paris, 2003. Stéphane Heuet : À la recherche du temps perdu, bande dessinée d’après Marcel Proust, 5 vol. parus, Delcourt, Tournai, Belgique, 1998-2008. Alberto Lombardo, L’Air de rien, adaptation théâtrale de À la recherche du temps perdu sur la relation Albertine-Marcel, 1988. À la recherche du temps perdu, version manga, traduit du japonais par Julien Lefebvre-Paquet, Soleil Manga, 2011 (ISBN 2-302-01879-6) Voir aussi Prix Marcel-Proust Prix de la Madeleine d’or L’hôtel littéraire Le Swann a été inauguré le 14 novembre 2013 pour le centenaire de la publication de Du côté de chez Swann, le premier tome d’À la recherche du temps perdu. Il est situé 11-15 rue de Constantinople à Paris, dans le 8e arrondissement. L’ensemble de la décoration rend hommage à Marcel Proust et à son œuvre et un espace d’exposition présente des livres rares et des manuscrits. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust

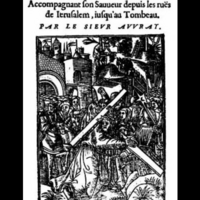
Jean Auvray, né vers 1580, probablement en Normandie et mort avant 1624, est un poète français. Jean Auvray a été chirurgien à Rouen, et ne saurait être confondu avec son homonyme dramaturge contemporain, avocat à Paris. Il appartient à la tradition de la satire normande dans la lignée de Vauquelin, Du Lorens, Angot de l’Éperonnière et Courval-Sonnet. Il est l’auteur d’écrits religieux et de satires. Alternant entre piété, cynisme et obscénité, sa poésie est cependant, selon certains critiques, la meilleure dans sa veine satirique. Il a aussi écrit une tragicomédie : l’Innocence descouverte (peut-être en 1609, dont on peut consulter le texte dans les seconde et troisième édition du Banquet des Muses). Tombeau du rud' en souppe Cy gist dans ce tombeau foireux Rud’ En-Souppe le valeureux, Qui voyant la guerre entreprise Au pays, et qu’on le cherchoit, Se cacha dessous la chemise De sa grand’ Jeanne qui pettoit : Luy qui trembloit tant escoutoit Tant redoubler de petarades, Saisi de peur creust qu’il estoit Au milieu des harquebusades : Qu’en advint-il ? Ses sens malades, Et le trou de son cul puant Perdant sa vertu retentrice, En lieu de combattre en la lice Il mourut de peur en chiant. Le Banquet des muses Œuvres * Le banquet des muses ou Les divers satires du sieur Auvray contenant plusieurs poëmes non encore veuës ny imprimez & L’innocence descouverte, tragi-comédie Rouen : D. Ferrand, 1623. * « La pourmenade de l’âme dévote accompagnant son Sauveur depuis les ruës de Jérusalem jusques au tombeau » [archive], Rouen : David Ferrand, 1633 (3e édition; N.B. : la première édition date de 1622) * « Les œuvres sainctes du sr Auvray : desquelles la plus grande partie n’ont encor esté veuës ny imprimées » [archive], Rouen : David Ferrand, 1634 (3e édition; N.B. : la première édition date de 1626) * L’Innocence découverte, Rouen, Petit, 1609. * Le Triomphe de la Croix, Rouen, D. Ferrand, 1622. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/


Jacques Delille, souvent appelé l’abbé Delille, né à Clermont-Ferrand le 22 juin 1738 et mort à Paris dans la nuit du 1er au 2 mai 1813, est un poète et traducteur français. Biographie Jacques, enfant naturel, conçu dans un jardin d’Aigueperse, naît chez un accoucheur, rue des Chaussetiers, à Clermont-Ferrand, le 22 juin 1738 de Marie-Hiéronyme Bérard, de la famille du chancelier Michel de l’Hospital. Il est reconnu par Antoine Montanier, avocat au Parlement de Clermont-Ferrand, qui meurt peu de temps après en lui laissant une modeste pension viagère de cent écus. Sa mère, aussi discrète que belle, lui transmet un pré, sis à Pontgibaud, ce qui lui permit d’adjoindre à son prénom le nom de famille Delille. Jusqu’à douze ou treize ans, il est placé chez une nourrice à Chanonat et reçoit ses premières leçons du curé du village. Envoyé à Paris, il fait de brillantes études au collège de Lisieux et devient maître de quartier au collège de Beauvais, puis professeur, d’abord au collège d’Amiens, ensuite au collège de la Marche à Paris. Il s’était déjà signalé par un remarquable talent de versificateur et une aptitude exceptionnelle à la poésie didactique. Sa gloire est assurée d’un coup par sa traduction en vers des Géorgiques de Virgile, qu’il publie en 1770. Louis Racine avait tenté de le dissuader de cette entreprise, qu’il jugeait téméraire, mais Delille avait persisté dans son dessein, et Louis Racine, convaincu par ses premiers essais, l’y avait encouragé. Son poème est accueilli par un concert de louanges, troublé seulement par la voix discordante de Jean-Marie-Bernard Clément, de Dijon. «Rempli de la lecture des Géorgiques de M. Delille, écrivit Voltaire à l’Académie française en mars 1772, je sens tout le prix de la difficulté si heureusement surmontée, et je pense qu’on ne pouvait faire plus d’honneur à Virgile et à la nation. Le poème des Saisons [de Jean-François de Saint-Lambert] et la traduction des Géorgiques me paraissent les deux meilleurs poèmes qui aient honoré la France après L’Art poétique [de Nicolas Boileau].» Delille est élu à l’Académie française en 1772, mais le maréchal de Richelieu intervient auprès de Louis XV pour faire annuler son élection au motif qu’il est trop jeune. Réélu en 1774, il est, cette fois, reçu par l’illustre compagnie, Jean-François de La Harpe ayant fait observer dans le Mercure de France qu’il était indigne qu’un talent aussi exceptionnel en soit réduit à dicter des thèmes latins à des écoliers. Il est, en outre, nommé à la chaire de poésie latine du Collège de France. L’ascension de Delille s’accélère encore après la mort de Voltaire, qui pouvait passer pour son seul rival. Tant la cour que le monde des lettres reconnaissent unanimement la supériorité de son talent. Il est à la fois le protégé de Marie-Thérèse Geoffrin et celui de Marie-Antoinette et du comte d’Artois. Ce dernier lui fait attribuer le bénéfice de l’abbaye de Saint-Séverin, qui rapportait 30 000 francs, tout en permettant de se borner aux ordres mineurs, que Delille avait reçus à Amiens en 1762. En 1782, la publication du poème des Jardins, sans doute l’œuvre la plus célèbre de Delille, est un nouveau triomphe, amplifié par le talent avec lequel l’auteur savait lire ses vers à l’Académie, au Collège de France ou dans les salons. Le comte de Choiseul-Gouffier parvient néanmoins à le persuader de s’arracher à tant d’adulation pour le suivre dans son ambassade de Constantinople. En 1786, il se met en ménage avec sa gouvernante, Marie-Jeanne Vaudechamps, qu’il épouse en 1799. Sous la Révolution française, ayant perdu le bénéfice qui était sa seule source de revenus, Delille est inquiété, mais conserve la liberté, sacrifiant aux idées de l’heure en composant, à la demande de Pierre-Gaspard Chaumette, un Dithyrambe sur l’Être suprême et l’immortalité de l’âme. Sous le Directoire, il se retire à Saint-Dié, pays de sa femme, puis quitte la France après la chute de Robespierre, au moment où d’autres y rentraient, pour passer en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Durant cet exil, poussé par sa femme, qui avait pris beaucoup d’ascendant sur lui, il travaille énormément. Il compose L’Homme des champs et entreprend Les Trois règnes de la nature en Suisse, compose La Pitié en Allemagne et traduit Paradise Lost (Le Paradis perdu) de John Milton à Londres. Rentré en France en 1802, il retrouve sa chaire au Collège de France et son fauteuil à l’Académie. Il effectue de longs séjours dans la maison de plaisance du baron Micoud d’Umons à Clamart, où il aurait écrit en 1808 Les Trois Règnes de la Nature. À la fin de sa vie, il devient aveugle, comme Homère, et cette infirmité ajoute encore à l’admiration proche de l’idolâtrie qui lui était vouée. Il meurt d’une attaque d’apoplexie dans la nuit du 1er au 2 mai 1813. Son corps est exposé pendant trois jours sur un lit de parade au Collège de France, le front ceint d’une couronne de laurier et, considéré comme le plus grand poète français, il reçoit des funérailles grandioses, suivies par une foule immense. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise (11e division). Œuvre Essai sur l’homme de Pope, 1765 Les Géorgiques de Virgile, 1770. Les Jardins ou l’art d’embellir les paysages, poème en 8 chants, 1782 Bagatelles jetées au vent, 1799 L’Homme des champs, ou les Géorgiques françaises, 1800 Dithyrambe sur l’immortalité de l’âme, 1802 Poésies fugitives, 1802 La Pitié, poème en 4 chants, 1803 L’Énéide de Virgile, 1804 Le Paradis perdu de Milton, 1805. L’Imagination, poème en 8 chants, 1806. Les Bucoliques de Virgile, 1806, réédité par Philippe Gonin, Paris, 1951, édition enrichie de bois gravés par Lucile Passavant (200 exemplaires). Les Trois Règnes de la nature, 1808 ( A Paris chez Nicolle et chez Giguet et Michaud) . La Conversation, poème, 1812.Ses œuvres complètes ont été publiées de 1817 à 1821 par Joseph-François Michaud, puis rééditées par Lefèvre en 1833, avec des notes de Choiseul-Gouffier, Parseval-Grandmaison, Charles-Marie de Féletz, Descuret, Aimé-Martin, Barthélemy Philibert d’Andrezel, Elzéar de Sabran (écrivain), Louis-Simon Auger, etc. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delille