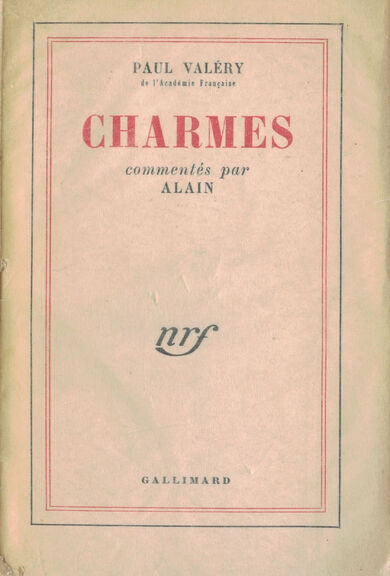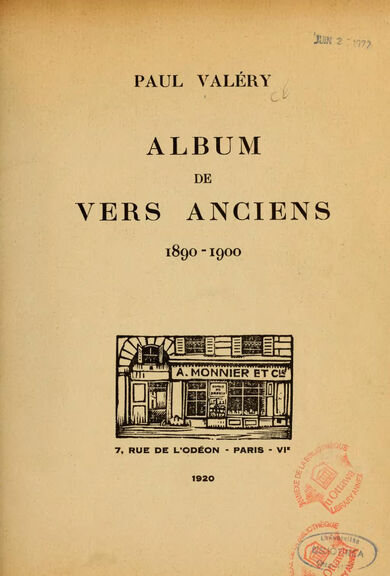A André Lebey.
Penché contre un grand fleuve, infiniment mes rames
M’arrachent à regret aux riants environs ;
Âme aux pesantes mains, pleines des avirons,
Il faut que le ciel cède au glas des lentes lames.
Le coeur dur, l’oeil distrait des beautés que je bats,
Laissant autour de moi mûrir des cercles d’onde,
Je veux à larges coups rompre l’illustre monde
De feuilles et de feu que je chante tout bas.
Arbres sur qui je passe, ample et naïve moire,
Eau de ramages peinte, et paix de l’accompli,
Déchire-les, ma barque, impose-leur un pli
Qui coure du grand calme abolir la mémoire.
Jamais, charmes du jour, jamais vos grâces n’ont
Tant souffert d’un rebelle essayant sa défense :
Mais, comme les soleils m’ont tiré de l’enfance,
Je remonte à la source où cesse même un nom.
En vain, toute la nymphe énorme et continue
Empêche de bras purs mes membres harassés ;
Je romprai lentement mille liens glacés
Et les barbes d’argent de sa puissance nue.
Ce bruit secret des eaux, ce fleuve étrangement
Place mes jours dorés sous un bandeau de soie ;
Rien plus aveuglément n’use l’antique joie
Qu’un bruit de fuite égale et de nul changement.
Sous les ponts annelés, l’eau profonde me porte,
Voûtes pleines de vent, de murmure et de nuit,
Ils courent sur un front qu’ils écrasent d’ennui,
Mais dont l’os orgueilleux est plus dur que leur porte.
Leur nuit passe longtemps. L’âme baisse sous eux
Ses sensibles soleils et ses promptes paupières,
Quand, par le mouvement qui me revêt de pierres,
Je m’enfonce au mépris de tant d’azur oiseux.