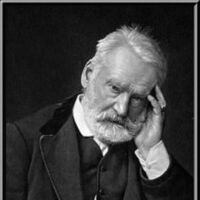Quiberon
I.
Par ses propres fureurs le Maudit se dévoile ;
Dans le démon vainqueur on voit l’ange proscrit ;
L’anathème éternel, qui poursuit son étoile,
Dans ses succès même est écrit.
Il est, lorsque des cieux nous oublions la voie,
Des jours, que Dieu sans doute envoie
Pour nous rappeler les enfers ;
Jours sanglants qui, voués au triomphe du crime,
Comme d’affreux rayons échappés de l’abîme,
Apparaissent sur l’univers.
Poètes qui toujours, loin du siècle où nous sommes,
Chantres des pleurs sans fin et des maux mérités,
Cherchez des attentats tels que la voix des hommes
N’en ait point encor racontés,
Si quelqu’un vient à vous vantant la jeune France,
Nos exploits, notre tolérance,
Et nos temps féconds en bienfaits,
Soyez contents ; lisez nos récentes histoires,
Evoquez nos vertus, interrogez nos gloires :—
Vous pourrez choisir des forfaits !
Moi, je n’ai point reçu de la Muse funèbre
Votre lyre de bronze, ô chantres des remords !
Mais je voudrais flétrir les bourreaux qu’on célèbre,
Et venger la cause des morts.
Je voudrais, un moment, troublant l’impur Génie.
Arrêter sa gloire impunie
Qu’on pousse à l’immortalité ;
Comme autrefois un grec, malgré les vents rapides,
Seul, retint de ses bras, de ses dents intrépides,
L’esquif sur les mers emporté !
II.
Quiberon vit jadis, sur son bord solitaire,
Des français assaillis s’apprêter à mourir,
Puis, devant les deux chefs, l’airain fumant se taire,
Et les rangs désarmés s’ouvrir.
Pour sauver ses soldats l’un d’eux offrit sa tête ;
L’autre accepta cette conquête,
De leur traité gage inhumain ;
Et nul guerrier ne crut sa promesse frivole,
Car devant les drapeaux, témoins de leur parole,
Tous deux s’étaient donné la main !
La phalange fidèle alors livra ses armes.
Ils marchaient ; une armée environnait leurs pas,
Et le peuple accourait, en répandant des larmes,
Voir ces preux, sauvés du trépas.
Ils foulaient en vaincus les champs de leurs ancêtres ;
Ce fut un vieux temple, sans prêtres,
Qui reçut ces vengeurs des rois ;
Mais l’humble autel manquait à la pieuse enceinte,
Et, pour se consoler, dans cette prison sainte,
Leurs yeux en vain cherchaient la croix.
Tous prièrent ensemble, et, d’une voix plaintive,
Tous, se frappant le sein, gémirent à genoux.
Un seul ne pleurait pas dans la tribu captive :
C’était lui qui mourait pour tous ;
C’était Sombreuil, leur chef : Jeune et plein d’espérance,
L’heure de son trépas s’avance ;
Il la salue avec ferveur.
Le supplice, entouré des apprêts funéraires,
Est beau pour un chrétien qui, seul, va pour ses frères
Expirer, semblable au Sauveur.
« Oh ! cessez, disait-il, ces larmes, ces reproches,
Guerriers ; votre salut prévient tant de douleurs !
Combien à votre mort vos amis et vos proches,
Hélas ! auraient versé de pleurs !
Je romps avec vos fers mes chaînes éphémères ;
À vos épouses, à vos mères,
Conservez vos jours précieux.
On vous rendra la paix, la liberté, la vie ;
Tout ce bonheur n’a rien que mon cœur vous envie ;
Vous, ne m’enviez pas les cieux. »
Le sinistre tambour sonna l’heure dernière,
Les bourreaux étaient prêts ; on vit Sombreuil partir.
La sœur ne fut point là pour leur ravir le frère,—
Et le héros devint martyr.
L’exhortant de la voix et de son saint exemple,
Un évêque, exilé du temple,
Le suivit au funeste lieu ;
Afin que le vainqueur vît, dans son camp rebelle,
Mourir, près d’un soldat à son prince fidèle,
Un prêtre fidèle à son Dieu !
III.
Vous pour qui s’est versé le sang expiatoire,
Bénissez le Seigneur, louez l’heureux Sombreuil ;
Celui qui monte au ciel, brillant de tant de gloire,
N’a pas besoin de chants de deuil !
Bannis, on va vous rendre enfin une patrie ;
Captifs, la liberté chérie
Se montre à vous dans l’avenir.
Oui, de vos longs malheurs chantez la fin prochaine ;
Vos prisons vont s’ouvrir, on brise votre chaîne ;
Chantez ! votre exil va finir.
En effet,—des cachots la porte à grand bruit roule,
Un étendard paraît, qui flotte ensanglanté ;
Des chefs et des soldats l’environnent en foule,
En invoquant la liberté !
« Quoi ! disaient les captifs, déjà l’on nous délivre !... »
Quelques uns s’empressent de suivre
Les bourreaux devenus meilleurs.
« Adieu, leur criait-on, adieu, plus de souffrance ;
Nous nous reverrons tous, libres, dans notre France ! »
Ils devaient se revoir ailleurs.
Bientôt, jusqu’aux prisons des captifs en prières,
Arrive un sourd fracas, par l’écho répété ;
C’étaient leurs fiers vainqueurs qui délivraient leurs frères,
Et qui remplissaient leur traité !
Sans troubler les proscrits, ce bruit vint les surprendre ;
Aucun d’eux ne savait comprendre
Qu’on pût se jouer des serments ;
Ils disaient aux soldats : « Votre foi nous protège ; »
Et, pour toute réponse, un lugubre cortège
Les traîna sur des corps fumants !
Le jour fit place à l’ombre et la nuit à l’aurore,
Hélas ! et, pour mourir traversant la cité,
Les crédules proscrits passaient, passaient encore,
Aux yeux du peuple éprouvant !
Chacun d’eux racontait, brûlant d’un sain délire,
À ses compagnons de martyre
Les malheurs qu’il avait soufferts ;
Tous succombaient sans peur, sans faste, sans murmure,
Regrettant seulement qu’il fallût un parjure,
Pour les immoler dans les fers.
À coups multipliés la hache abat les chênes.
Le vil chasseur, dans l’antre ignoré du soleil,
Egorge lentement le lion dont ses chaînes
Ont surpris le noble sommeil.
On massacra longtemps la tribu sans défense.
À leur mort assistait la France,
Jouet des bourreaux triomphants ;
Comme jadis, aux pieds des idoles impures,
Tour à tour, une veuve, en de longues tortures,
Vit expirer ses sept enfants.
C’étaient là les vertus d’un sénat qu’on nous vante !
Le sombre esprit du mal sourit en le créant ;
Mais ce corps aux cent bras, fort de notre épouvante,
En son sein portait son néant.
Le colosse de fer s’est dissous dans la fange.
L’anarchie, alors que tout change,
Pense voir ses œuvres durer ;
Mais ce Pygmalion, dans ses travaux frivoles,
Ne peut donner la vie aux horribles idoles
Qu’il se fait pour les adorer.
IV.
On dit que, de nos jours, viennent, versant des larmes,
Prier au champ fatal où ces preux sont tombés,
Les vierges, les soldats fiers de leurs jeunes armes,
Et les vieillards lents et courbés.
Du ciel sur les bourreaux appelant l’indulgence,
Là, nul n’implore la vengeance,
Tous demandent le repentir ;
Et chez ces vieux bretons, témoins de tant de crimes,
Le pèlerin, qui vient invoquer les victimes,
Souvent lui-même est un martyr.
Du 11 au 17 février 1821.
Odes et ballades (1826)