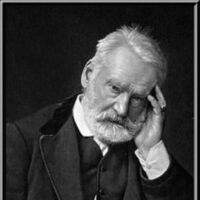Le cheval
Je l’avais saisi par la bride ;
Je tirais, les poings dans les noeuds,
Ayant dans les sourcils la ride
De cet effort vertigineux.
C’était le grand cheval de gloire,
Né de la mer comme Astarté,
À qui l’aurore donne à boire
Dans les urnes de la clarté ;
L’alérion aux bonds sublimes,
Qui se cabre, immense, indompté,
Plein du hennissement des cimes,
Dans la bleue immortalité.
Tout génie, élevant sa coupe,
Dressant sa torche, au fond des cieux,
Superbe, a passé sur la croupe
De ce monstre mystérieux.
Les poètes et les prophètes,
Ô terre, tu les reconnais
Aux brûlures que leur ont faites
Les étoiles de son harnais.
Il souffle l’ode, l’épopée,
Le drame, les puissants effrois,
Hors des fourreaux les coups d’épée,
Les forfaits hors du coeur des rois.
Père de la source sereine,
Il fait du rocher ténébreux
Jaillir pour les Grecs Hippocrène
Et Raphidim pour les Hébreux.
Il traverse l’Apocalypse ;
Pâle, il a la mort sur son dos.
Sa grande aile brumeuse éclipse
La lune devant Ténédos.
Le cri d’Amos, l’humeur d’Achille
Gonfle sa narine et lui sied ;
La mesure du vers d’Eschyle,
C’est le battement de son pied.
Sur le fruit mort il penche l’arbre,
Les mères sur l’enfant tombé ;
Lugubre, il fait Rachel de marbre,
Il fait de pierre Niobé.
Quand il part, l’idée est sa cible ;
Quand il se dresse, crins au vent,
L’ouverture de l’impossible
Luit sous ses deux pieds de devant.
Il défie Éclair à la course ;
Il a le Pinde, il aime Endor ;
Fauve, il pourrait relayer l’Ourse
Qui traîne le Chariot d’or.
Il plonge au noir zénith ; il joue
Avec tout ce qu’on peut oser ;
Le zodiaque, énorme roue,
A failli parfois l’écraser.
Dieu fit le gouffre à son usage.
Il lui faut les cieux non frayés,
L’essor fou, l’ombre, et le passage
Au-dessus des pics foudroyés.
Dans les vastes brumes funèbres
Il vole, il plane ; il a l’amour
De se ruer dans les ténèbres
Jusqu’à ce qu’il trouve le jour.
Sa prunelle sauvage et forte
Fixe sur l’homme, atome nu,
L’effrayant regard qu’on rapporte
De ces courses dans l’inconnu.
Il n’est docile, il n’est propice
Qu’à celui qui, la lyre en main,
Le pousse dans le précipice,
Au-delà de l’esprit humain.
Son écurie, où vit la fée,
Veut un divin palefrenier ;
Le premier s’appelait Orphée ;
Et le dernier, André Chénier.
Il domine notre âme entière ;
Ézéchiel sous le palmier
L’attend, et c’est dans sa litière
Que Job prend son tas de fumier.
Malheur à celui qu’il étonne
Ou qui veut jouer avec lui !
Il ressemble au couchant d’automne
Dans son inexorable ennui.
Plus d’un sur son dos se déforme ;
Il hait le joug et le collier ;
Sa fonction est d’être énorme
Sans s’occuper du cavalier.
Sans patience et sans clémence,
Il laisse, en son vol effréné,
Derrière sa ruade immense
Malebranche désarçonné.
Son flanc ruisselant d’étincelles
Porte le reste du lien
Qu’ont tâché de lui mettre aux ailes
Despréaux et Quintilien.
Pensif, j’entraînais loin des crimes,
Des dieux, des rois, de la douleur,
Ce sombre cheval des abîmes
Vers le pré de l’idylle en fleur.
Je le tirais vers la prairie
Où l’aube, qui vient s’y poser,
Fait naître l’églogue attendrie
Entre le rire et le baiser.
C’est là que croît, dans la ravine
Où fuit Plaute, où Racan se plaît,
L’épigramme, cette aubépine,
Et ce trèfle, le triolet.
C’est là que l’abbé Chaulieu prêche,
Et que verdit sous les buissons
Toute cette herbe tendre et fraîche
Où Segrais cueille ses chansons.
Le cheval luttait ; ses prunelles,
Comme le glaive et l’yatagan,
Brillaient ; il secouait ses ailes
Avec des souffles d’ouragan.
Il voulait retourner au gouffre ;
Il reculait, prodigieux,
Ayant dans ses naseaux le soufre
Et l’âme du monde en ses yeux.
Il hennissait vers l’invisible ;
Il appelait l’ombre au secours ;
À ses appels le ciel terrible
Remuait des tonnerres sourds.
Les bacchantes heurtaient leurs cistres,
Les sphinx ouvraient leurs yeux profonds ;
On voyait, à leurs doigts sinistres,
S’allonger l’ongle des griffons.
Les constellations en flamme
Frissonnaient à son cri vivant
Comme dans la main d’une femme
Une lampe se courbe au vent.
Chaque fois que son aile sombre
Battait le vaste azur terni,
Tous les groupes d’astres de l’ombre
S’effarouchaient dans l’infini.
Moi, sans quitter la plate-longe,
Sans le lâcher, je lui montrais
Le pré charmant, couleur de songe,
Où le vers rit sous l’antre frais.
Je lui montrais le champ, l’ombrage,
Les gazons par juin attiédis ;
Je lui montrais le pâturage
Que nous appelons paradis.
—Que fais-tu là ? me dit Virgile.
Et je répondis, tout couvert
De l’écume du monstre agile :
—Maître, je mets Pégase au vert.
Les chansons des rues et des bois (1865)