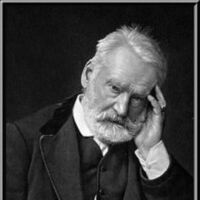Joyeuse vie
I.
Bien ! pillards, intrigants, fourbes, crétins, puissances !
Attablez-vous en hâte autour des jouissances !
Accourez ! place à tous !
Maîtres, buvez, mangez, car la vie est rapide.
Tout ce peuple conquis, tout ce peuple stupide,
Tout ce peuple est à vous !
Vendez l’état ! coupez les bois ! coupez les bourses !
Videz les réservoirs et tarissez les sources !
Les temps sont arrivés.
Prenez le dernier sou ! prenez, gais et faciles,
Aux travailleurs des champs, aux travailleurs des villes !
Prenez, riez, vivez !
Bombance ! allez ! c’est bien ! vivez ! faites ripaille !
La famille du pauvre expire sur la paille,
Sans porte ni volet.
Le père en frémissant va mendier dans l’ombre ;
La mère n’ayant plus de pain, dénûment sombre,
L’enfant n’a plus de lait.
II.
Millions ! millions ! châteaux ! liste civile !
Un jour je descendis dans les caves de Lille
Je vis ce morne enfer.
Des fantômes sont là sous terre dans des chambres,
Blêmes, courbés, ployés ; le rachis tord leurs membres
Dans son poignet de fer.
Sous ces voûtes on souffre, et l’air semble un toxique
L’aveugle en tâtonnant donne à boire au phtisique
L’eau coule à longs ruisseaux ;
Presque enfant à vingt ans, déjà vieillard à trente,
Le vivant chaque jour sent la mort pénétrante
S’infiltrer dans ses os.
Jamais de feu ; la pluie inonde la lucarne ;
L’œil en ces souterrains où le malheur s’acharne
Sur vous, ô travailleurs,
Près du rouet qui tourne et du fil qu’on dévide,
Voit des larves errer dans la lueur livide
Du soupirail en pleurs.
Misère ! l’homme songe en regardant la femme.
Le père, autour de lui sentant l’angoisse infâme
Etreindre la vertu,
Voit sa fille rentrer sinistre sous la porte,
Et n’ose, l’œil fixé sur le pain qu’elle apporte,
Lui dire : D’où viens-tu ?
Là dort le désespoir sur son haillon sordide ;
Là, l’avril de la vie, ailleurs tiède et splendide,
Ressemble au sombre hiver ;
La vierge, rose au jour, dans l’ombre est violette ;
Là, rampent dans l’horreur la maigreur du squelette,
La nudité du ver ;
Là frissonnent, plus bas que les égouts des rues,
Familles de la vie et du jour disparues,
Des groupes grelottants ;
Là, quand j’entrai, farouche, aux méduses pareille,
Une petite fille à figure vieille
Me dit : J’ai dix-huit ans !
Là, n’ayant pas de lit, la mère malheureuse
Met ses petits enfants dans un trou qu’elle creuse,
Tremblants comme l’oiseau ;
Hélas ! ces innocents aux regards de colombe
Trouvent en arrivant sur la terre une tombe
En place d’un berceau !
Caves de Lille ! on meurt sous vos plafonds de pierre !
J’ai vu, vu de ces yeux pleurant sous ma paupière,
Râler l’aïeul flétri,
La fille aux yeux hagards de ses cheveux vêtue,
Et l’enfant spectre au sein de la mère statue !
Ô Dante Alighieri !
C’est de ces douleurs-là que sortent vos richesses,
Princes ! ces dénûments nourrissent vos largesses,
Ô vainqueurs ! conquérants !
Votre budget ruisselle et suinte à larges gouttes
Des murs de ces caveaux, des pierres de ces voûtes,
Du cœur de ces mourants.
Sous ce rouage affreux qu’on nomme tyrannie,
Sous cette vis que meut le fisc, hideux génie,
De l’aube jusqu’au soir,
Sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes
Ainsi que des raisins on écrase des hommes,
Et l’or sort du pressoir.
C’est de cette détresse et de ces agonies,
De cette ombre, où jamais, dans les âmes ternies,
Espoir, tu ne vibras,
C’est de ces bouges noirs pleins d’angoisses amères,
C’est de ce sombre amas de pères et de mères
Qui se tordent les bras,
Oui, c’est de ce monceau d’indigences terribles
Que les lourds millions, étincelants, horribles,
Semant l’or en chemin,
Rampant vers les palais et les apothéoses,
Sortent, monstres joyeux et couronnés de roses,
Et teints de sang humain !
III.
Ô paradis ! splendeurs ! versez à boire aux maîtres !
L’orchestre rit, la fête empourpre les fenêtres,
La table éclate et luit ;
L’ombre est là sous leurs pieds ! les portes sont fermées
La prostitution des vierges affamées
Pleure dans cette nuit !
Vous tous qui partagez ces hideuses délices,
Soldats payés, tribuns vendus, juges complices,
Évêques effrontés,
La misère frémit sous ce Louvre où vous êtes !
C’est de fièvre et de faim et de mort que sont faites
Toutes vos voluptés !
À Saint-Cloud, effeuillant jasmins et marguerites,
Quand s’ébat sous les fleurs l’essaim des favorites,
Bras nus et gorge au vent,
Dans le festin qu’égaie un lustre à mille branches,
Chacune, en souriant, dans ses belles dents blanches
Mange un enfant vivant !
Mais qu’importe ! riez ! Se plaindra-t-on sans cesse ?
Serait-on empereur, prélat, prince et princesse,
Pour ne pas s’amuser ?
Ce peuple en larmes, triste, et que la faim déchire,
Doit être satisfait puisqu’il vous entend rire
Et qu’il vous voit danser !
Qu’importe ! Allons, emplis ton coffre, emplis ta poche.
Chantez, le verre en main, Troplong, Sibour, Baroche !
Ce tableau nous manquait.
Regorgez, quand la faim tient le peuple en sa serre,
Et faites, au –dessus de l’immense misère,
Un immense banquet !
IV.
Ils marchent sur toi, peuple ! Ô barricade sombre,
Si haute hier, dressant dans les assauts sans nombre
Ton front de sang lavé,
Sous la roue emportée, étincelante et folle,
De leur coupé joyeux qui rayonne et qui vole,
Tu redeviens pavé !
À César ton argent, peuple ; à toi la famine.
N’es-tu pas le chien vil qu’on bat et qui chemine
Derrière son seigneur ?
À lui la pourpre ; à toi la hotte et les guenilles.
Peuple, à lui la beauté de ces femmes, tes filles,
À toi leur déshonneur !
V.
Ah ! quelqu’un parlera. La muse, c’est l’histoire.
Quelqu’un élèvera la voix dans la nuit noire.
Riez, bourreaux bouffons !
Quelqu’un te vengera, pauvre France abattue,
Ma mère ! et l’on verra la parole qui tue
Sortir des cieux profonds !
Ces gueux, pires brigands que ceux des vieilles races,
Rongeant le pauvre peuple avec leurs dents voraces,
Sans pitié, sans merci,
Vils, n’ayant pas de cœur, mais ayant deux visages,
Disent :—Bah ! le poète ! il est dans les nuages !—
Soit. Le tonnerre aussi.
Le 19 janvier 1853.
Les châtiments (1853)