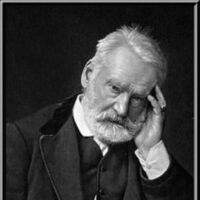Fuite en Sologne
Au poète Mérante.
I.
Ami, viens me rejoindre.
Les bois sont innocents.
Il est bon de voir poindre
L’aube des paysans.
Paris, morne et farouche,
Pousse des hurlements
Et se tord sous la douche
Des noirs événements.
Il revient, loi sinistre,
Étrange état normal !
À l’ennui par le cuistre
Et par le monstre au mal.
II.
J’ai fui ; viens. C’est dans l’ombre
Que nous nous réchauffons.
J’habite un pays sombre
Plein de rêves profonds.
Les récits de grand-mère
Et les signes de croix
Ont mis une chimère
Charmante dans les bois.
Ici, sous chaque porte,
S’assied le fabliau,
Nain du foyer qui porte
Perruque in-folio.
L’elfe dans les nymphées
Fait tourner ses fuseaux ;
Ici l’on a des fées
Comme ailleurs des oiseaux.
Le conte, aimé des chaumes,
Trouve au bord des chemins,
Parfois, un nid de gnomes
Qu’il prend dans ses deux mains.
Les follets sont des drôles
Pétris d’ombre et d’azur
Qui font au creux des saules
Un flamboiement obscur.
Le faune aux doigts d’écorce
Rapproche par moments
Sous la table au pied torse
Les genoux des amants.
Le soir un lutin cogne
Aux plafonds des manoirs ;
Les étangs de Sologne
Sont de pâles miroirs.
Les nénuphars des berges
Me regardent la nuit ;
Les fleurs semblent des vierges ;
L’âme des choses luit.
III.
Cette bruyère est douce ;
Ici le ciel est bleu,
L’homme vit, le blé pousse
Dans la bonté de Dieu.
J’habite sous les chênes
Frémissants et calmants ;
L’air est tiède, et les plaines
Sont des rayonnements.
Je me suis fait un gîte
D’arbres, sourds à nos pas ;
Ce que le vent agite,
L’homme ne l’émeut pas.
Le matin, je sommeille
Confusément encor.
L’aube arrive vermeille
Dans une gloire d’or.
—Ami, dit la ramée,
Il fait jour maintenant.—
Une mouche enfermée
M’éveille en bourdonnant.
IV.
Viens, loin des catastrophes,
Mêler sous nos berceaux
Le frisson de tes strophes
Au tremblement des eaux.
Viens, l’étang solitaire
Est un poème aussi.
Les lacs ont le mystère,
Nos coeurs ont le souci.
Tout comme l’hirondelle,
La stance quelquefois
Aime à mouiller son aile
Dans la mare des bois.
C’est, la tête inondée
Des pleurs de la forêt,
Que souvent le spondée
À Virgile apparaît.
C’est des sources, des îles,
Du hêtre et du glaïeul
Que sort ce tas d’idylles
Dont Tityre est l’aïeul.
Segrais, chez Pan son hôte,
Fit un livre serein
Où la grenouille saute
Du sonnet au quatrain.
Pendant qu’en sa nacelle
Racan chantait Babet,
Du bec de la sarcelle
Une rime tombait.
Moi, ce serait ma joie
D’errer dans la fraîcheur
D’une églogue où l’on voie
Fuir le martin-pêcheur.
L’ode même, superbe,
Jamais ne renia
Toute cette grande herbe
Où rit Titania.
Ami, l’étang révèle
Et mêle, brin à brin,
Une flore nouvelle
Au vieil alexandrin.
Le style se retrempe
Lorsque nous le plongeons
Dans cette eau sombre où rampe
Un esprit sous les joncs.
Viens, pour peu que tu veuilles
Voir croître ton vers
La sphaigne aux larges feuilles
Et les grands roseaux verts.
Les chansons des rues et des bois (1865)