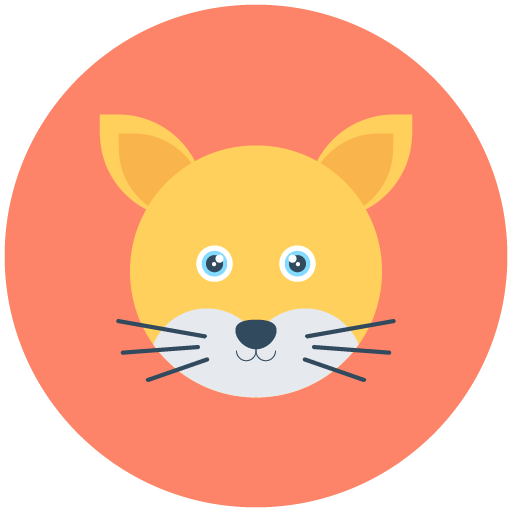Cur aliquid vidi?
I
Que tu brilles enfin, terme pur de ma course!
Ce soir, comme d’un cerf, la fuite vers la source
Ne cesse qu’il ne tombe au milieu des roseaux,
Ma soif me vient abattre au bord même des eaux.
Mais, pour désaltérer cette amour curieuse,
Je ne troublerai pas l’onde mystérieuse:
Nymphes! si vous m’aimez, il faut toujours dormir!
La moindre âme dans l’air vous fait toutes frémir;
Même, dans sa faiblesse, aux ombres échappée,
Si la feuille éperdue effleure la napée,
Elle suffit à rompre un univers dormant...
Votre sommeil importe à mon enchantement,
Il craint jusqu’au frisson d’une plume qui plonge!
Gardez-moi longuement ce visage pour songe
Qu’une absence divine est seule à concevoir!
Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez de me voir!
Rêvez, rêvez de moi!... Sans vous, belles fontaines,
Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines.
Je chercherais en vain ce que j’ai de plus cher,
Sa tendresse confuse étonnerait ma chair,
Et mes tristes regards, ignorants de mes charmes,
À d’autres que moi-même. adresseraient leurs larmes...
Vous attendiez, peut-être, un visage sans pleurs,
Vous calmes, vous toujours de feuilles et de fleurs,
Et de l’incorruptible altitude hantées,
Ô Nymphes!... Mais docile aux pentes enchantées
Qui me firent vers vous d’invincibles chemins,
Souffrez ce beau reflet des désordres humains!
Heureux vos corps fondus, Eaux planes et profondes!
Je suis seul!... Si les Dieux, les échos et les ondes
Et si tant de soupirs permettent qu’on le soit!
Seul!... mais encor celui qui s’approche de soi
Quand il s’approche aux bords que bénit ce feuillage...
Des cimes, l’air déjà cesse le pur pillage;
La voix des sources change, et me parle du soir;
Un grand calme m’écoute, où j’écoute l’espoir.
J’entends l’herbe des nuits croître dans l’ombre sainte,
Et la lune perfide élève son miroir
Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte...
Jusque dans les secrets que je crains de savoir,
Jusque dans le repli de l’amour de soi-même,
Rien ne peut échapper au silence du soir...
La nuit vient sur ma chair lui souffler que je l’aime.
Sa voix fraîche à mes voeux tremble de consentir;
À peine, dans la brise, elle semble mentir,
Tant le frémissement de son temple tacite
Conspire au spacieux silence d’un tel site.
Ô douceur de survivre à la force du jour,
Quand elle se retire enfin rose d’amour,
Encore un peu brûlante, et lasse, mais comblée,
Et de tant de trésors tendrement accablée
Par de tels souvenirs qu’ils empourprent sa mort,
Et qu’ils la font heureuse agenouiller dans l’or,
Puis s’étendre, se fondre, et perdre sa vendange,
Et s’éteindre en un songe en qui le soir se change.
Quelle perte en soi-même offre un si calme lieu!
L’âme, jusqu’à périr, s’y penche pour un Dieu
Qu’elle demande à l’onde, onde déserte, et digne
Sur son lustre, du lisse effacement d’un cygne...
À cette onde jamais ne burent les troupeaux!
D’autres, ici perdus, trouveraient le repos,
Et dans la sombre terre, un clair tombeau qui s’ouvre...
Mais ce n’est pas le calme, hélas! que j’y découvre!
Quand l’opaque délice où dort cette clarté,
Cède à mon corps l’horreur du feuillage écarté,
Alors, vainqueur de l’ombre, ô mon corps épaisseur panique,
Tu regrettes bientôt leur éternelle nuit!
Pour l’inquiet Narcisse, il n’est ici qu’ennui!
Tout m’appelle et m’enchaîne à la chair lumineuse
Que m’oppose des eaux la paix vertigineuse!
Que je déplore ton éclat fatal et pur,
Si mollement de moi, fontaine environnée,
Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur,
Les yeux mêmes et noirs de leur âme étonnée!
Profondeur, profondeur, songes qui me voyez,
Comme ils verraient une autre vie
Dites, ne suis-je pas celui que vous croyez,
Votre corps vous fait-il envie?
Cessez, sombres esprits, cet ouvrage anxieux
Qui se fait dans l’âme qui veille;
Ne cherchez pas en vous, n’allez surprendre aux cieux
Le malheur d’être une merveille:
Trouvez dans la fontaine un corps délicieux...
Prenant à vos regards cette parfaite proie,
Du monstre de s’aimer faites-vous un captif;
Dans les errants filets de vos longs cils de soie
Son gracieux éclat vous retienne pensif;
Mais ne vous flattez pas de le changer d’empire.
Ce cristal est son vrai séjour;
Les efforts mêmes de l’amour
Ne le sauraient de l’onde extraire qu’il n’expire. . .
Pire.
Pire?
Quelqu’un redit « Pire ». . . Ô moqueur!
Écho lointaine et prompte à rendre son oracle!
De son rire enchanté, le roc brise mon coeur,
Et le silence, par miracle,
Cesse!... parle, renaît, sur la face des eaux. . .
Pire?...
Pire destin!... Vous le dites, roseaux,
Qui reprîtes des vents ma plainte vababonde!
Antres, qui me rendez mon âme plus profonde,
Vous renflez de votre ombre une voix qui se meurt. . .
Vous me le murmurez, ramures!... Ô rumeur
Déchirante, et docile aux souffles sans figure,
Votre or léger s’agite, et joue avec l’augure. . .
Tout se mêle de moi, brutes divinités!
Mes secrets dans les airs sonnent ébruités,
Le roc rit; l’arbre pleure; et par sa voix charmante,
Je ne puis qu’aux cieux que je ne me lamente
D’appartenir sans force d’éternels attraits!
Hélas! entre les bras qui naissent des forêts,
Une tendre lueur d’heure ambiguë existe. . .
Là, d’un reste du jour, se forme un fiancé,
Nu, sur la place pâle où m’attire l’eau triste,
Délicieux démon désirable et glacé!
Te voici, mon doux corps de lune et de rosée,
Ô forme obéissante à mes voeux opposée!
Qu’ils sont beaux, de mes bras les dons vastes et vains!
Mes lentes mains, dans l’or adorable se lassent
D’appeler ce captif que les feuilles enlacent;
Mon coeur jette aux échos l’éclat des noms divins!
Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème!
Ô semblable! Et pourtant plus parfait que moi-même,
Éphémère immortel, si clair devant mes yeux,
Pâles membres de perle, et ces cheveux soyeux,
Faut-il qu’à peine aimés, l’ombre les obscurcisse,
Et que la nuit déjà nous divise, ô Narcisse,
Et glisse entre nous deux le fer qui coupe un fruit!
Qu’as-tu?
Ma plainte même est funeste?
Le bruit
Du souffle que j’enseigne à tes lèvres, mon double,
Sur la limpide lame a fait courir un trouble!
Tu trembles!... Mais ces mots que j’iexpire à genoux
Ne sont pourtant qu’une âme hésitante entre nous,
Entre ce front si pur et ma lourde mémoire...
Je suis si près de toi que je pourrais te boire,
Ô visage!... Ma soif est un esclave nu...
Jusqu’à ce temps charmant je m’étais inconnu,
Et je ne savais pas me chérir et me joindre!
Mais te voir, cher esclave, obéir à la moindre
Des ombres dans mon coeur se fuyant à regret,
Voir sur mon front l’orage et les feux d’un secret,
Voir, ô merveille, voir! ma bouche nuancée
Trahir... peindre sur l’onde une fleur de pensée,
Et quels événements étinceler dans l’oeil!
J’y trouve un tel trésor d’impuissance et d’orgueil,
Que nulle vierge enfant échappée au satyre,
Nulle! aux fuites habiles, aux chutes sans émoi,
Nulle des nymphes, nulle amie, ne m’attire
Comme tu fais sur l’onde, inépuisable Moi!...
II
Fontaine, ma fontaine, eau froidement présente,
Douce aux purs animaux, aux humains complaisante
Qui d’eux-mêmes tentés suivent au fond la mort,
Tout est songe pour toi, Soeur tranquille du Sort!
À peine en souvenir change-t-il un présage,
Que pareille sans cesse à son fuyant visage,
Sitôt de ton sommeil les cieux te sont ravis!
Mais si pure tu sois des êtres que tu vis,
Onde, sur qui les ans passent comme les nues,
Que de choses pourtant doivent t’être connues,
Astres, roses, saisons, les corps et leurs amours!
Claire, mais si profonde, une nymphe toujours
Effleurée, et vivant de tout ce qui l’approche,
Nourrit quelque sagesse à l’abri de sa roche,
À l’ombre de ce jour qu’elle peint sous les bois.
Elle sait à jamais les choses d’une fois...
Ô présence pensive, eau calme qui recueilles
Tout un sombre trésor de fables et de feuilles,
L’oiseau mort, le fruit mûr, lentement descendus,
Et les rares lueurs des clairs anneaux perdus.
Tu consommes en toi leur perte solennelle;
Mais, sur la pureté de ta face éternelle,
L’amour passe et périt...
Quand le feuillage épars
Tremble, commence à fuir, pleure de toutes parts,
Tu vois du sombre amour s’y mêler la tourmente,
L’amant brûlant et dur ceindre la blanche amante,
Vaincre l’âme... Et tu sais selon quelle douceur
Sa main puissante passe à travers l’épaisseur
Des tresses que répand la nuque précieuse,
S’y repose, et se sent forte et mystérieuse;
Elle parle à l’épaule et règne sur la chair.
Alors les yeux fermés à l’éternel éther
Ne voient plus que le sang qui dore leurs paupières;
Sa pourpre redoutable obscurcit les lumières
D’un couple aux pieds confus qui se mêle, et se ment.
Ils gémissent... La Terre appelle doucement
Ces grands corps chancelants, qui luttent bouche à bouche,
Et qui, du vierge sable osant battre la couche,
Composeront d’amour un monstre qui se meurt...
Leurs souffles ne font plus qu’une heureuse rumeur,
L’âme croit respirer l’âme toute prochaine,
Mais tu sais mieux que moi, vénérable fontaine,
Quels fruits forment toujours ces moments enchantés!
Car, à peine les coeurs calmes et contentés
D’une ardente alliance expirée en délices,
Des amants détachés tu mires les malices,
Tu vois poindre des jours de mensonges tissus,
Et naître mille maux trop tendrement conçus!
Bientôt, mon onde sage, infidèle et la même,
Le Temps mène ces fous qui crurent que l’on aime
Redire à tes roseaux de plus profonds soupirs!
Vers toi, leurs tristes pas suivent leurs souvenirs...
Sur tes bords, accablés d’ombres et de faiblesse,
Tout éblouis d’un ciel dont la beauté les blesse
Tant il garde l’éclat de leurs jours les plus beaux,
Ils vont des biens perdus trouver tous les tombeaux...
« Cette place dans l’ombre était tranquille et nôtre! »
« L’autre aimait ce cyprès, se dit le coeur de l’autre,
« Et d’ici, nous goûtions le souffle de la mer! »
Hélas! la rose même est amère dans l’air...
Moins amers les parfums des suprêmes fumées
Qu’abandonnent au vent les feuilles consummées!...
Ils respirent ce vent, marchent sans le savoir,
Foulent aux pieds le temps d’un jour de désespoir...
Ô marche lente, prompte, et pareille aux pensées
Qui parlent tour à tour aux têtes insensées!
La caresse et le meurtre hésitent dans leurs mains,
Leur coeur, qui croit se rompre au détour des chemins,
Lutte, et retient à soi son espérance étreinte.
Mais leurs esprits perdus courent ce labyrinthe
Où s’égare celui qui maudit le soleil!
Leur folle solitude, à l’égal du sommeil,
Peuple et trompe l’absence; et leur secrète oreille
Partout place une voix qui n’a point de pareille.
Rien ne peut dissiper leurs songes absolus;
Le soleil ne peut rien contre ce qui n’est plus!
Mais s’ils traînent dans l’or leurs yeux secs et funèbres,
Ils se sentent des pleurs défendre leurs ténèbres
Plus chères à jamais que tous les feux du jour!
Et dans ce corps caché tout marqué de l’amour
Que porte amèrement l’âme qui fut heureuse,
Brûle un secret baiser qui la rend furieuse...
Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux
Que de ma seule essence;
Tout autre n’a pour moi qu’un coeur mystérieux,
Tout autre n’est qu’absence.
Ô mon bien souverain, cher corps, je n’ai que toi!
Le plus beau des mortels ne peut chérir que soi...
Douce et dorée, est-il une idole plus sainte,
De toute une forêt qui se consume, ceinte,
Et sise dans l’azur vivant par tant d’oiseaux?
Est-il don plus divin de la faveur des eaux,
Et d’un jour qui se meurt plus adorable usage
Que de rendre à mes yeux l’honneur de mon visage?
Naisse donc entre nous que la lumière unit
De grâce et de silence un échange infini!
Je vous salue, enfant de mon âme et de l’onde,
Cher trésor d’un miroir qui partage le monde!
Ma tendresse y vient boire, et s’enivre de voir
Un désir sur soi-même essayer son pouvoir!
Ô qu’à tous mes souhaits, que vous êtes semblable!
Mais la fragilité vous fait inviolable,
Vous n’êtes que lumière, adorable moitié
D’une amour trop pareille à la faible amitié!
Hélas! la nymphe même a séparé nos charmes!
Puis-je espérer de toi que de vaines alarmes?
Qu’ils sont doux les périls que nous pourrions choisir!
Se surprendre soi-même et soi-même saisir,
Nos mains s’entremêler, nos maux s’entre-détruire,
Nos silences longtemps de leurs songes s’instruire,
La même nuit en pleurs confondre nos yeux clos,
Et nos bras refermés sur les mêmes sanglots
Étreindre un même coeur, d’amour prêt à se fondre...
Quitte enfin le silence, ose enfin me répondre,
Bel et cruel Narcisse, inaccessible enfant,
Tout orné de mes biens que la nymphe défend...
III
... Ce corps si pur, sait-il qu’il me puisse séduire?
De quelle profondeur songes-tu de m’instruire,
Habitant de l’abîme, hôte si précieux
D’un ciel sombre ici-bas précipité des cieux?
Ô le frais ornement de ma triste tendance
Qu’un sourire si proche, et plein de confidence,
Et qui prête à ma lèvre une ombre de danger
Jusqu’à me faire craindre un désir étranger!
Quel souffle vient à l’onde offrir ta froide rose!...
« J’aime... J’aime!... » Et qui donc peut aimer autre chose
Que soi-même?...
Toi seul, ô mon corps, mon cher corps,
Je t’aime, unique objet qui me défends des morts.
. . . . . . . . . . .
Formons, toi sur ma lèvre, et moi, dans mon silence,
Une prière aux dieux qu’émus de tant d’amour
Sur sa pente de pourpre ils arrêtent le jour!...
Faites, Maîtres heureux, Pères des justes fraudes,
Dites qu’une lueur de rose ou d’émeraudes
Que des songes du soir votre sceptre reprit,
Pure, et toute pareille au plus pur de l’esprit,
Attende, au sein des cieux, que tu vives et veuilles,
Près de moi, mon amour, choisir un lit de feuilles,
Sortir tremblant du flanc de la nymphe au coeur froid,
Et sans quitter mes yeux, sans cesser d’être moi,
Tendre ta forme fraîche, et cette claire écorce...
Oh! te saisir enfin!... Prendre ce calme torse
Plus pur que d’une femme et non formé de fruits...
Mais, d’une pierre simple est le temple où je suis,
Où je vis. . . Car je vis sur tes lèvres avares!...
Ô mon corps, mon cher corps, temple qui me sépares
De ma divinité, je voudrais apaiser
Votre bouche... Et bientôt, je briserais, baiser,
Ce peu qui nous défend de l’extrême existence,
Cette tremblante, frêle, et pieuse distance
Entre moi-même et l’onde, et mon âme, et les dieux!
Adieu... Sens-tu frémir mille flottants adieux?
Bientôt va frissonner le désordre des ombres!
L’arbre aveugle vers l’arbre étend ses membres sombres,
Et cherche affreusement l’arbre qui disparaît...
Mon âme ainsi se perd dans sa propre forêt,
Où la puissance échappe à ses formes suprêmes...
L’âme, l’âme aux yeux noirs, touche aux ténèbres mêmes,
Elle se fait immense et ne rencontre rien...
Entre la mort et soi, quel regard est le sien!
Dieux! de l’auguste jour, le pâle et tendre reste
Va des jours consumés joindre le sort funeste;
Il s’abîme aux enfers du profond souvenir!
Hélas! corps misérable, il est temps de s’unir...
Penche-toi... Baise-toi. Tremble de tout ton être!
L’insaisissable amour que tu me vins promettre
Passe, et dans un frisson, brise Narcisse, et fuit...