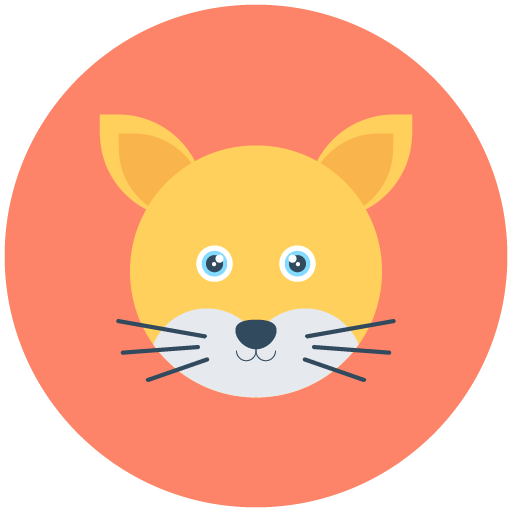Parthénope et l’Étrangère
À M. Pouqueville
O femme, que veux-tu ? – Parthénope, un asile.
–Quel est ton crime ? – Aucun. – Qu’as-tu fait ? – Des ingrats.
–Quels sont tes ennemis ? – Ceux qu’affranchit mon bras ;
Hier on m’adorait, aujourd’hui l’on m’exile.
–Comment dois-tu payer mon hospitalité ?
–Par des périls d’un jour et des lois éternelles.
–Qui t’osera poursuivre au sein de ma cité ?
–Des rois. – Quand viendront-ils ? – Demain. – De quel côté ?
–De tous... Eh bien ! Pour moi tes portes s’ouvrent-elles ?
–Entre ; quel est ton nom ? – Je suis la Liberté !
Recevez-la, remparts antiques,
Par elle autrefois habités ;
Au rang de vos divinités
Recevez-la, sacrés portiques ;
Levez-vous, ombres héroïques,
Faites cortége à ses côtés.
Beau ciel napolitain, rayonne d’allégresse ;
Ô terre, enfante des soldats ;
Et vous, peuples, chantez ; peuples, c’est la déesse
Pour qui mourut Léonidas.
Sa tête a dédaigné des ornemens futiles :
Les siens sont quelques fleurs qui semblent s’entr’ouvrir ;
Le sang les fit éclore au pied des thermopyles :
Deux mille ans n’ont pu les flétrir.
Sa couronne immortelle exhale sur sa trace
Je ne sais quel parfum dont s’enivre l’audace ;
Sa voix terrible et douce a des accens vainqueurs,
Qui ne trouvent point de rebelle ;
Ses yeux d’un saint amour font palpiter les cœurs,
Et la vertu seule est plus belle.
Le peuple se demande, autour d’elle arrêté,
Comment elle a des rois encouru la colère.
« Hélas ! Répond cette noble étrangère,
Je leur ai dit la vérité.
Si jamais sous mon nom l’imprudence ou la haine
Ébranla leur pouvoir, que je veux contenir,
Est-ce à moi d’en porter la peine ?
Est-ce aux Germains à m’en punir ?
« Ont-ils donc oublié, ces vaincus de la veille,
Ces esclaves d’hier, aujourd’hui vos tyrans,
Que leurs cris de détresse ont frappé mon oreille,
Qu’auprès d’Arminius j’ai marché dans leurs rangs ?
Seule, j’ai rallié leurs peuplades tremblantes ;
Et, de la Germanie armant les défenseurs,
J’ai creusé de mes mains, dans ses neiges sanglantes,
Un lit de mort aux oppresseurs.
« Vengez-moi, justes dieux qui voyez mes outrages.
Puisse le souvenir de mes bienfaits passés
Poursuivre ces ingrats, par l’effroi dispersés !
Puissent les fils d’Odin errans sur les nuages,
Le front chargé d’orages,
La nuit leur apparaître à la lueur des feux !
Et puissent les débris des légions romaines,
Dont j’ai blanchi leurs plaines,
Se lever devant eux !
« Que dis-je ? Rome entière est-elle ensevelie
Dans la poudre de leurs sillons ?
Mon pied, frappant le sein de l’antique Italie,
En fait jaillir des bataillons.
Rome, ne sens-tu pas, au fond de tes entrailles,
S’agiter les froids ossemens
Des guerriers citoyens, que tant de funérailles
Ont couchés sous tes monumens ?
« Génois, brisez vos fers ; la mer impatiente
De vous voir secouer un indigne repos,
Se gonfle avec orgueil sous la forêt flottante
Où vous arborez mes drapeaux.
« Veuve des Médicis, renais, noble Florence !
Préfère à ton repos tes droits que je défends ;
Préfère à l’esclavage, où dorment tes enfans,
Ton orageuse indépendance.
« Ô fille de Neptune, ô Venise, ô cité
Belle comme Vénus, et qui sortis comme elle
De l’écume des flots, surpris de ta beauté,
Épouvante Albion d’une splendeur nouvelle.
Doge, règne en mon nom ; sénat, reconnais-moi ;
Réveille-toi, Zéno ; Pisani, lève-toi :
C’est la liberté qui t’appelle. »
Elle dit : à sa voix s’agite un peuple entier.
Dans la fournaise ardente
Je vois blanchir l’acier :
J’entends le fer crier
Sous la lime mordante ;
L’enclume au loin gémit, l’airain sonne, un guerrier
Prépare à ce signal sa lance menaçante,
Un autre son coursier.
Le père chargé d’ans, mais jeune encor d’audace,
Arme son dernier fils, le devance et prend place
Au milieu des soldats.
Arrêté par sa sœur qui rit de sa colère,
L’enfant dit à sa mère :
Je veux mourir dans les combats.
Que n’auraient-ils pas fait, ceux en qui la vaillance
Avait la force pour appui ?
Quel homme dans la fuite eût mis son espérance,
Et quel homme aurait craint pour lui
Cette mort que cherchaient la vieillesse et l’enfance ?
Ils s’écrièrent tous d’une commune voix :
« Assis sous ton laurier que nous courons défendre,
Virgile, prends ta lyre et chante nos exploits ;
Jamais un oppresseur ne foulera ta cendre. »
Ils partirent alors ces peuples belliqueux,
Et trente jours plus tard, oppresseur et tranquille,
Le germain triomphant s’enivrait avec eux
Au pied du laurier de Virgile.
La Liberté fuyait en détournant les yeux,
Quand Parthénope la rappelle.
La déesse un moment s’arrête au haut des cieux ;
« Tu m’as trahie ; adieu, dit-elle,
Je pars. – Quoi ! Pour toujours ? – On m’attend. – Dans quel lieu ?
–En Grèce. – On y suivra tes traces fugitives.
–J’aurai des défenseurs. – Là, comme sur mes rives,
On peut céder au nombre. – Oui, mais on meurt ; adieu ! »
Les Messéniennes, Livre II (1835)