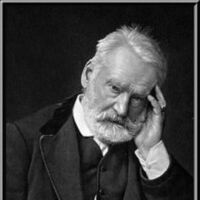Tristesse d’Olympio
Les champs n’étaient point noirs, les cieux n’étaient pas mornes.
Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes
Sur la terre étendu,
L’air était plein d’encens et les prés de verdures
Quand il revit ces lieux où par tant de blessures
Son cœur s’est répandu !
L’automne souriait ; les coteaux vers la plaine
Penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine ;
Le ciel était doré ;
Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme,
Disant peut-être à Dieu quelque chose de l’homme,
Chantaient leur chant sacré !
Il voulut tout revoir, l’étang près de la source,
La masure où l’aumône avait vidé leur bourse,
Le vieux frêne plié,
Les retraites d’amour au fond des bois perdues,
L’arbre où dans les baisers leurs âmes confondues
Avaient tout oublié !
Il chercha le jardin, la maison isolée,
La grille d’où l’œil plonge en une oblique allée,
Les vergers en talus.
Pâle, il marchait. – Au bruit de son pas grave et sombre,
Il voyait à chaque arbre, hélas ! se dresser l’ombre
Des jours qui ne sont plus !
Il entendait frémir dans la forêt qu’il aime
Ce doux vent qui, faisant tout vibrer en nous-même,
Y réveille l’amour,
Et, remuant le chêne ou balançant la rose,
Semble l’âme de tout qui va sur chaque chose
Se poser tour à tour !
Les feuilles qui gisaient dans le bois solitaire,
S’efforçant sous ses pas de s’élever de terre,
Couraient dans le jardin ;
Ainsi, parfois, quand l’âme est triste, nos pensées
S’envolent un moment sur leurs ailes blessées,
Puis retombent soudain.
Il contempla longtemps les formes magnifiques
Que la nature prend dans les champs pacifiques ;
Il rêva jusqu’au soir ;
Tout le jour il erra le long de la ravine,
Admirant tour à tour le ciel, face divine,
Le lac, divin miroir !
Hélas ! se rappelant ses douces aventures,
Regardant, sans entrer, par-dessus les clôtures,
Ainsi qu’un paria,
Il erra tout le jour. Vers l’heure où la nuit tombe,
Il se sentit le cœur triste comme une tombe,
Alors il s’écria :
« Ô douleur ! j’ai voulu, moi dont l’âme est troublée,
Savoir si l’urne encor conservait la liqueur,
Et voir ce qu’avait fait cette heureuse vallée
De tout ce que j’avais laissé là de mon cœur !
« Que peu de temps suffit pour changer toutes choses !
Nature au front serein, comme vous oubliez !
Et comme vous brisez dans vos métamorphoses
Les fils mystérieux où nos cœurs sont liés !
« Nos chambres de feuillage en halliers sont changées !
L’arbre où fut notre chiffre est mort ou renversé ;
Nos roses dans l’enclos ont été ravagées
Par les petits enfants qui sautent le fossé !
« Un mur clôt la fontaine où, par l’heure échauffée,
Folâtre, elle buvait en descendant des bois ;
Elle prenait de l’eau dans sa main, douce fée,
Et laissait retomber des perles de ses doigts !
« On a pavé la route âpre et mal aplanie,
Où, dans le sable pur se dessinant si bien,
Et de sa petitesse étalant l’ironie,
Son pied charmant semblait rire à côté du mien !
« La borne du chemin, qui vit des jours sans nombre,
Où jadis pour m’attendre elle aimait à s’asseoir,
S’est usée en heurtant, lorsque la route est sombre,
Les grands chars gémissants qui reviennent le soir.
« La forêt ici manque et là s’est agrandie.
De tout ce qui fut nous presque rien n’est vivant ;
Et, comme un tas de cendre éteinte et refroidie,
L’amas des souvenirs se disperse à tout vent !
« N’existons-nous donc plus ? Avons-nous eu notre heure ?
Rien ne la rendra-t-il à nos cris superflus ?
L’air joue avec la branche au moment où je pleure ;
Ma maison me regarde et ne me connaît plus.
« D’autres vont maintenant passer où nous passâmes.
Nous y sommes venus, d’autres vont y venir ;
Et le songe qu’avaient ébauché nos deux âmes,
Ils le continueront sans pouvoir le finir !
« Car personne ici-bas ne termine et n’achève ;
Les pires des humains sont comme les meilleurs ;
Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve.
Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs.
« Oui, d’autres à leur tour viendront, couples sans tache,
Puiser dans cet asile heureux, calme, enchanté,
Tout ce que la nature à l’amour qui se cache
Mêle de rêverie et de solennité !
« D’autres auront nos champs, nos sentiers, nos retraites ;
Ton bois, ma bien-aimée, est à des inconnus.
D’autres femmes viendront, baigneuses indiscrètes,
Troubler le flot sacré qu’ont touché tes pieds nus !
« Quoi donc ! c’est vainement qu’ici nous nous aimâmes !
Rien ne nous restera de ces coteaux fleuris
Où nous fondions notre être en y mêlant nos flammes !
L’impassible nature a déjà tout repris.
« Oh ! dites-moi, ravins, frais ruisseaux, treilles mûres,
Rameaux chargés de nids, grottes, forêts, buissons,
Est-ce que vous ferez pour d’autres vos murmures ?
Est-ce que vous direz à d’autres vos chansons ?
« Nous vous comprenions tant ! doux, attentifs, austères,
Tous nos échos s’ouvraient si bien à votre voix !
Et nous prêtions si bien, sans troubler vos mystères,
L’oreille aux mots profonds que vous dites parfois !
« Répondez, vallon pur, répondez, solitude,
Ô nature abritée en ce désert si beau,
Lorsque nous dormirons tous deux dans l’attitude
Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau ;
« Est-ce que vous serez à ce point insensible
De nous savoir couchés, morts avec nos amours,
Et de continuer votre fête paisible,
Et de toujours sourire et de chanter toujours ?
« Est-ce que, nous sentant errer dans vos retraites,
Fantômes reconnus par vos monts et vos bois,
Vous ne nous direz pas de ces choses secrètes
Qu’on dit en revoyant des amis d’autrefois ?
« Est-ce que vous pourriez, sans tristesse et sans plainte,
Voir nos ombres flotter où marchèrent nos pas,
Et la voir m’entraîner, dans une morne étreinte,
Vers quelque source en pleurs qui sanglote tout bas ?
« Et s’il est quelque part, dans l’ombre où rien ne veille,
Deux amants sous vos fleurs abritant leurs transports,
Ne leur irez-vous pas murmurer à l’oreille :
–Vous qui vivez, donnez une pensée aux morts !
« Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines,
Les grands bois frissonnants, les rocs profonds et sourds
Et les cieux azurés et les lacs et les plaines,
Pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours !
« Puis il nous les retire. Il souffle notre flamme ;
Il plonge dans la nuit l’antre où nous rayonnons ;
Et dit à la vallée, où s’imprima notre âme,
D’effacer notre trace et d’oublier nos noms.
« Eh bien ! oubliez-nous, maison, jardin, ombrages !
Herbe, use notre seuil ! ronce, cache nos pas !
Chantez, oiseaux ! ruisseaux, coulez ! croissez, feuillages !
Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas.
« Car vous êtes pour nous l’ombre de l’amour même !
Vous êtes l’oasis qu’on rencontre en chemin !
Vous êtes, ô vallon, la retraite suprême
Où nous avons pleuré nous tenant par la main !
« Toutes les passions s’éloignent avec l’âge,
L’une emportant son masque et l’autre son couteau,
Comme un essaim chantant d’histrions en voyage
Dont le groupe décroît derrière le coteau.
« Mais toi, rien ne t’efface, amour ! toi qui nous charmes,
Toi qui, torche ou flambeau, luis dans notre brouillard !
Tu nous tiens par la joie, et surtout par les larmes ;
Jeune homme on te maudit, on t’adore vieillard.
« Dans ces jours où la tête au poids des ans s’incline,
Où l’homme, sans projets, sans but, sans visions,
Sent qu’il n’est déjà plus qu’une tombe en ruine
Où gisent ses vertus et ses illusions ;
« Quand notre âme en rêvant descend dans nos entrailles,
Comptant dans notre cœur, qu’enfin la glace atteint,
Comme on compte les morts sur un champ de batailles,
Chaque douleur tombée et chaque songe éteint,
« Comme quelqu’un qui cherche en tenant une lampe,
Loin des objets réels, loin du monde rieur,
Elle arrive à pas lents par une obscure rampe
Jusqu’au fond désolé du gouffre intérieur ;
« Et là, dans cette nuit qu’aucun rayon n’étoile,
L’âme, en un repli sombre où tout semble finir,
Sent quelque chose encor palpiter sous un voile...
C’est toi qui dors dans l’ombre, ô sacré souvenir ! »
Le 21 octobre 1837.
Les rayons et les ombres (1840)